01/08/2001 - Christine Coudray
Soluble dans l'eau - Chapitre III
Je ne m’en suis pas rendue compte au début. Cela s’est fait à mon insu. Je suis devenue taciturne, je parlais un minimum, juste suffisamment pour que cela ne paraisse pas suspect et que l’on ne me pose pas de question à ce sujet. Autrement dit, je ne souhaitais qu'une chose : qu’on me foute la paix.
Tout s'éloignait de moi. Lentement. Inexorablement.
Mes collègues de travail sont devenus des ombres. Leurs paroles me parvenaient de loin, comme aba-sourdies.
Je ne répondais plus au téléphone, il sonnait dans le vide. J'étais ce vide.
Doucement, j'ai oublié qu'il existait des normes, des horaires à respecter. Ce bureau où j'étais censée me rendre tous les jours est devenu un vague souvenir. Bien sûr, j'ai fini par recevoir ma lettre de licencie-ment. Je ne me suis pas pressée pour l'ouvrir. Les coordonnées de l'expéditeur étaient inscrites sur l'enveloppe, aussi je savais que ce n'était pas toi qui m'écrivais, alors, à quoi bon ? Au fil des jours, de ma boîte aux lettres se déversaient les mauvaises nouvelles. Quoique, mauvaises, non, je ne suis pas sûr qu'elles l'étaient. C'était celles que j'attendais. Je laissais les rouages bien huilés de la société décidés à ma place. Cependant, dans un ultime effort, j'ai quitté mon appartement, de moi-même, sans attendre l'huissier, n'emportant que l'essentiel : quelques vêtements et des livres, ces amis qui ne vous quittent jamais.
J'ai pris le bus et j'ai gagné le centre ville. J'avais pris soin de conserver un peu d'argent, histoire que le passage d'une vie à une autre ne soit pas trop diffi-cile. Je ne craignais pas de croiser des fantômes de mon ancienne vie. Déjà, je sentais que j'avais revêtu l'uniforme de passe-muraille, gris-vert, comme la moisissure recouvrant les corps morts, qui me ren-dait invisible aux yeux de la foule déambulant d'un lieu à un autre, un autre lieu dont ils pouvaient dire qu'il était leur foyer, l'abri de leur intimité.
Moi, d'intimité, je n'en avais plus, tu l'avais emporté avec toi. Au fond, mon seul foyer, c'était toi, ton épaule faite pour que j'y pose la tête, tes bras faits pour m'entourer, tes mains destinées à reposer sur mes reins ; quant au reste mieux vaut ne pas y pen-ser. Les souvenirs de la volupté sont des blessures trop cruelles. Je ne pouvais plus avoir de domicile puisque tu t'étais soustrait à moi. Je ne cherchais plus qu'une chose : laisser couler sur moi le temps, en espérant qu'il m'érode. Je ne pouvais pas marcher indéfiniment, il me fallait trouver un endroit pour me poser, un banc où m'asseoir. Ce n'est pas les bancs qui manquaient dans cette ville. Au contraire, il y en avait même trop : j'allais devoir choisir ; c'était là une tâche ardue pour le monument d'irrésolution que j'étais devenue.
Au bout de quelques heures, je trouvais l'endroit idéal. C'était devant la gare. Finalement, je m'étais décidée pour un endroit passant. Mais ces passants-là me convenaient : ils étaient des voyageurs. Parmi eux, je distinguais rapidement ceux qui quittaient leurs chez- eux de ceux qui y retournaient. Les pre-miers arboraient un air indécis, vaguement inquiet, l'air de ceux qui ne savent pas vers quoi ils vont ; tandis que les seconds esquissaient de vagues souri-res, satisfaits de retourner dans leurs cocons.
Et puis, j'aimais l'idée d'être prés des trains. Nous nous en étions tant servis toi et moi. Grâce à eux, je n'avais jamais eu l'impression d'être séparée de toi par des kilomètres mais seulement par du temps. Le train avait ce pouvoir magique : il convertissait les distances en temps. Longtemps, je n'avais été qu'à deux heures de toi. Monter dans un train était comme pénétrer dans une autre dimension. Plus rien ne semblait réel de ce que l'on voyait au dehors. Le nombre des vivants se limitaient alors aux passagers du compartiment. Les paysages le long de la voie étaient comme des décors créés par une main hu-maine pour une longue maquette. Les voitures aux passages à niveau semblaient être des jouets.
Heureusement, il y avait les terminus qui nous ré-unissaient et ton contact me ramenait dans notre monde. Aussitôt descendue du wagon, l'illusion d'avoir formé une communauté d'âmes avec ces in-dividus s'évanouissait. Ne restaient plus que toi et moi, le temps d'un week-end.
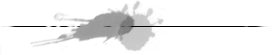
Réagir à ce texte (e-mail à l'auteur) :
|

