01/08/2001 - Christine Coudray
Soluble dans l'eau - Chapitre IV
Après quelques nuits passées dehors et bien que, cette année –là l'hiver ne soit pas trop rigoureux, il me parut évident qu'il me fallait trouver un refuge pour la nuit. Je n'eus aucun mal à y parvenir : il me suffit, à la nuit tombante de suivre un de ces êtres à l'allure miteuse pour découvrir ce qu'en terme admi-nistratif osé on appelle un "foyer" de nuit. Les pre-miers temps furent désagréables : je devais accepter de sentir sur moi des regards, qui n'étaient pas inqui-siteurs mais pires que cela. Ils signifiaient : nous sommes identiques, nos parcours sont les mêmes. Hors je ne voulais rien avoir en commun avec ces gens puisque certains d'entre eux souhaitaient re-couvrir leur identité, reprendre consistance aux yeux du monde. Mais moi je ne souhaitais qu'une chose, la perdre et garder cette invisibilité que j'avais acquise.
Au bout de quelques nuits, cette nouvelle réalité devint acceptable. Je ne pouvais pas me dérober à ce que je nommais en moi -même des procédures :donner son nom, s'asseoir à une table, attendre le repas, puis passer à la douche et se glisser dans un lit inconfortable, tenter d'y gagner quelques heures d'inconscience. C'est le moment de la douche qu'au fil des jours j'appris à savourer et à en faire durer le plaisir. Je me créais pour cela un rite. Il consistait à donner au jet le maximum de sa puissance. La vio-lence du flux me permettait de croire que ma peau s'arrachait, de croire que j'accédais à un stade sup-érieur de transparence. Je basculais la tête en arrière et buvais, buvais toute l'eau que je pouvais. Cela faisait glisser la boule qui me serrait la gorge jusque dans mon ventre. Après je me sentais suffisamment bien pour pouvoir affronter ce lieu sordide que le dortoir était à mes yeux. Le plus rapidement possi-ble, je me glissais dans mon lit, me recouvrais de la couverture rêche. Je me couchais en chien de fusil et balançais mon corps de gauche à droite. Le poids de l'eau en moi se faisait plus intense, une boule dure. C'est mon âme que je berçais, comme un enfant que l'on attend.
Un jour passa près de mon banc une femme dont la grâce me toucha. Pour la première fois depuis long-temps longtemps j'eus envie de parler à un être humain. En quelques secondes, elle avait pris plus de consistance à mes yeux que n'en avait jamais eu ma vie sociale passée.
Malheureusement, dès les premiers mots je me ren-dis compte que cette apparition qui ne s'était pas effarouchée de mon air d'épouvantail était folle. Folle à lier, invisiblement. Je l'enviais, lui enviais cette folie qui la liait, la retenait à je ne sais quoi, je ne sais comment ; moi qui n'étais plus qu 'une vagabonde.
Les vagabonds et les fous suivent des voix parallèles. Jamais ils ne se croisent, jamais ne se rencontrent. Il y a entre eux un mur invisible, une dernière frontière : la raison des vagabonds.
Cette épisode me fît comprendre que je ne pouvais plus continuer comme çà. Il fallait que cela cesse, que je mette un terme à ce qui n'était même plus une vie.
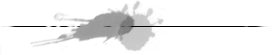
Réagir à ce texte (e-mail à l'auteur) :
|

