21/11/2002 - Chahrazed Labiod
Retrouvailles - Chapitres 1 à 3
CHAPITRE I
Paris ! la fascinante, altière, somptueuse, sombre par certains endroits, Paris l’implacable dominait tout le monde. Seuls, les nantis faisaient communion avec elle. Pourtant ! Dans son giron, généreusement, elle abritait des êtres de races différentes ainsi que de religions différentes.
Paris la mystérieuse, cosmopolite, attirait du monde pour diverses raisons. Je ne voyais aucune corrélation entre ce que je vivais avec les Parisiens et la vie au sein de ma famille. Quand mes parents parlaient entre eux, je saisissais à peine le sens de quelques mots puisque leur conversation, en langage kabyle, m’était étrangère. Lorsque mon père ou ma mère s’adressait à l’un de nous, ils utilisaient le français même si la langue était mal employée.
Une fois en dehors du gîte, la société, l’école auxquelles les tout jeunes immigrés étaient confrontés, rectifiaient leurs erreurs. Alors, ils s’exprimaient comme tous les Parisiens. L’accent et même l’argot faisaient partie du patrimoine culturel de l’immigré. Je savais malgré tout que j’étais différente de la majorité des Parisiens mais sans savoir avec exactitude, pourquoi ? Mon parlé, mes jeux, étaient pareils à ceux de mes camarades. Je m’interrogeais de nouveau. Quelles similitudes culturelles me liaient en plus aux Parisiens ?
Soudain ! C’était la différence qui me vint à l’esprit, celle de l’aspect physique, juste un détail, mais il avait son importance. Il m’arrivait d’être accostée par une personne âgée qui me disait avec un sourire amusé : « Pourrais-tu me donner tes cheveux en échange des miens ? » Une cascade de boucles noires paraît ma tête. Je crois que la vue quasi permanente des cheveux dorés, les lassait un peu malgré leur magnificence.
Un jour parmi tant d’autres lorsque nous n’avions pas classe, mes deux sœurs et moi-même, allions nous distraire dans le jardin public qui se trouvait dans notre arrondissement. Nous n’étions ni heureuses, ni tristes. Sur les lieux de détente avec de petites hésitations pour le choix du jeu, nous nous décidâmes selon le tempérament de chacune à nous amuser avec ce que nous préférions. Les bacs à sable étaient pour les tout-petits qui avec assiduité, fabriquaient des pâtés avec leurs attirails en plastique. En vain, ils démolissaient leurs constructions en recommençant de nouvelles œuvres, sans se décourager, encore et encore jusqu'à la lassitude. La fatigue salutaire au corps et à l’esprit leur permettait de s’arrêter un moment pour le goûter que leurs parents s’étaient appliqués à leurs préparer. Les uns sortaient d’un sachet en papier, des gâteaux, d’autres du pain, du fromage ou du chocolat. Cela variait, selon le goût ou la bourse des gens qui les accompagnaient.
D’autres enfants plus grands, s’agglutinaient derrière un toboggan. Ils chahutaient. Avec une dextérité relative, ils glissaient sur la pente de bois en se laissant emporter par la vitesse génératrice d’émotion. Les balançoires aussi étaient bien cotées par la marmaille. Je ne trouvais aucune originalité à ces jeux. J’étais plutôt attirée par le manège avec ses chevaux de bois. Les couleurs vives et les mouvements artificiels rotatifs des bêtes me subjuguaient. Je les regardais longuement, emportée, bercée par leurs tournoiements réguliers quand, subitement ! ils arrêtaient leur ronde, obéissant docilement à leur propriétaire. Je sentais comme une relation affective entre moi et ces gentils animaux qui m’enchantaient. Je gardais au fond de ma poche, une pièce de vingt centimes que je pressais de temps à autre avec ma petite main. Je m’assurais qu’elle n’était pas perdue. Je quittai avec regret mes compagnons les chevaux de bois sans avoir pu les monter. Je n’avais pas la somme nécessaire pour un tour de manège. Lorsque l’on était un enfant immigré, généralement on n’avait pas les moyens d’acheter les plaisirs que Paris pouvait procurer, même les joies les plus insignifiantes. Les parents des enfants immigrés étaient pour la plupart analphabètes ou sans qualification. Ils travaillaient dans les usines comme manœuvres ou bien dans les chantiers où s’élevaient de gigantesques bâtiments ainsi que dans ce qui avait trait à la voirie. La sale besogne était hélas, le lot des émigrés qui avaient quitté leur pays d’origine. Les uns fuyaient la guerre, d’autres la misère, pour certains la volonté farouche les guidait vers un autre pays avec l’espoir que « les fées » existaient peut être, enfin ! réaliser un de leur plus beau fantasme, Le bonheur … !
Je rejoignis mes sœurs. Samia était mon aînée de trois ans quant à Kheira, c’était la cadette. Elle était plus jeune que moi de seulement deux années. Je jouais avec elles et d’autres camarades aux « gendarmes et aux voleurs ». La place et les caches ne manquaient pas contrairement à nos habitations. La journée se termina bon gré, mal gré, fourbues d’avoir joué à tout et à n’importe quoi comme à « saute-mouton » où à fabriquer des petits bateaux en papier que nous larguions sur l’eau paisible d’un bassin. On les observait voguer, entraînés au hasard par les sillons que faisaient d’autres engins nautiques. Les jouets étaient de merveilleuses mécaniques qui n’avaient pas l’attrait de nos créations. Notre imaginaire d’enfant les considérait comme de vraies embarcations prêtes à l’aventure que chacune vivait selon ses désirs secrets. C’étaient les jeux de notre époque. Nous étions en 1961, j’avais 7 ans. La France était moderne mais pas encore suffisamment pour que naissent des déviations dans le comportement des individus. La drogue, la pédophilie, l’homosexualité, étaient des expressions qui n’existaient pas dans le vocable enfantin. Des pratiques de ce genre auraient été des cas isolés dans une France encore puritaine et conservatrice. Les valeurs judéo-chrétiennes n’étaient en rien différentes pour l’essentiel à celles de l’islam, puisque chaque religion incite à aimer un Dieu unique, à prôner le bien envers autrui ainsi que l’équité entre les hommes. L’évolution des mœurs n’était pas encore à l’apogée. Cela ne voulait pas dire que nous étions à l’abri de fléaux sociaux. Les frustrations ne manquaient pas. Des petits larcins de bonbons en particulier ou « bombeks » dans le langage parisien, chez la boulangère qui avait un coin pour les douceurs et les paquets surprises en papier coloré. Les plus hardis chapardaient aussi bien dans une épicerie que dans un « prisunic ». La tentation des cigarettes se faisait sentir plutôt rarement, nos maigres moyens pécuniaires n’étaient guère en rapport avec leurs prix inabordables. Mais ! Il y avait un jeu qui consistait à aller derrière la raffinerie de sucre qui se trouvait à quelques mètres de notre immeuble situé dans le 13ième arrondissement. Des charrettes de clochards étaient garées à l’arrière de l’usine. Les carrioles nous fascinaient. Elles étaient comme la caverne d’Ali Baba, remplies de divers trésors. Les sans abris y avaient entassé, pèle-mêle, des cageots, des vieilles frusques, du bric à brac dont on ne comprenait pas l’importance ainsi que des bouteilles de vin. Ma sœur Samia que l’on qualifiait souvent d’effrontée pour son espièglerie débordante, vola une bouteille de vin. Elle fit croire à nos deux copines que la plus audacieuse serait celle qui en boirait le plus. Samia offrit sans restriction les premières lampées à Nicole et à Martine. Elles burent goulûment. Quand vint mon tour pour les gorgées couleur framboise, Samia m’arracha intempestivement la bouteille, en revanche, elle permit aux deux héroïnes d’en boire le plus possible. Sans méfiance, allègrement, les filles s’abreuvaient de la curieuse boisson.
Samia voulait les saouler. C’était un de ses tours pour s’amuser. À la fin de ce jeu stupide, j’observais l’endroit où l’on avait accompli notre forfait. C’était une propriété privée, ses résidents s’en étaient absentés. Une allée bordée de marronniers et tapissée de petits cailloux, menait vers une jolie demeure qui n’existait pour moi que dans les livres d’images. La maison avec un étage était en pierres et à la toiture d’ardoise. On devinait malgré son aspect un peu vieillot et rustique, un intérieur confortable, peut-être luxueux. Je l’admirais un moment. Elle me paraissait mystérieuse. Je ne connaissais point les gens qu’elle abritait ni l’histoire de leur vie ….. « Etait-elle palpitante, morose… ? Je ne le saurai jamais ! » Je regardais attentivement les marrons qui jonchaient le sol. Leurs couleurs luisantes me faisaient presque oublier la laideur et la froideur du béton qui régnaient en maître dans la grande ville. Il fallait tuer le temps. On ne savait pas toujours, comment ? L’oisiveté nous guettait, nous débordions d’énergie. Si, celle-ci n’était pas canalisée, nous risquions d’être comme un bateau qui dérive, échouant, on ne sait où ?
Nos journées de repos s’écoulaient ainsi dans une banalité la plus totale. Parfois, à l’occasion des courses dont on devait s’acquitter pour la maisonnée, il nous arrivait de rencontrer des amoureux. Ils étaient maladroitement dissimulés derrière un arbre ou assis sur un banc public, ils se bécotaient. On les regardait ingénument. Un tel spectacle attirait notre curiosité, mais celui qui me charmait quand j’en avais l’occasion, c’était la vue des mariés. Après avoir fait consacrer leur mariage religieusement par le curé de la paroisse, je les admirais quand ils se faisaient prendre en photo à la sortie de l’église, accompagnés de leurs familles et de leurs convives. La mariée dans une jolie robe blanche telle une princesse, se tenait au bras de son époux élégamment vêtu. Des demoiselles d’honneur portaient la traîne de la robe de mariée, elles étaient aussi les stars de la cérémonie. Une France traditionnelle qui paraissait en accord avec elle-même et sa culture.
Ces images de la vie quotidienne dont on était gavé faisaient désormais partie de notre culture. Spontanément, d’une manière automatique, on épousait l’identité culturelle du pays où l’on était née même si pour les parents, la France restait une terre d’exil.
Nous quittâmes le jardin aux environs de quatre heures. Il nous restait assez de temps avant de retourner à la maison pour flâner dans Paris. Nous arpentions ses rues bruyantes et grouillantes de monde qui nous faisaient nous fondre dans la foule. Les gens pressaient le pas, indifférents à l’autre. Je me sentais comme un objet sans valeur dans un décor somptueux ou bien comme une intruse qui se serait faufilée parmi les personnages d’une représentation théâtrale. Nous nous arrêtions de temps à autre pour regarder sans enthousiasme, le nez presque collé à la vitrine, des beaux vêtements qui garnissaient la devanture d’un magasin. Avec envie, nous scrutions la panoplie de jouets. A l’approche d’une pâtisserie, d’exquises odeurs s’exhalaient, chatouillant à faire frémir de plaisir, les narines des passants. Avec émerveillement nous admirions les gâteaux que l’on pouvait voir de l’extérieur. Paris était comme une grande dame qui submergeait de désir par ses charmes inaccessibles, toutes les personnes séduites par elle. De nouveau, je tâtai ma petite pièce qui ne pouvait guère m’offrir les plaisirs que détenait la ville jalousement.
Cahin-caha, nous reprîmes notre chemin pour nous arrêter devant un cinéma. Nous observions attentivement les affiches des films qui devaient passer en salle. Perdue dans mes pensées en face des acteurs des grandes images, je me délectais en essayant de deviner l’histoire. Malgré une imagination débordante, je n’arrivais pas à trouver les réponses aux questions que je me posais, tandis qu’une curiosité intérieure me dévorait. Je sentais un immense sentiment d’insatiabilité en étudiant les magnifiques personnages des affiches qui dominaient tous ceux qui les regardaient. Avec regret, nous quittâmes l’endroit, insouciantes de l’heure à laquelle nous devions rentrer au bercail. Nous traversâmes une place couverte de pigeons. A Paris ! Il y avait beaucoup de pigeons dans certains de ces endroits. Une veille femme assise sur un banc public, jetait des graines aux volatiles qui se bourraient du précieux aliment. Ils n’étaient pas effrayés de notre présence. Interloquée ! Je les épiais un laps de temps. Ils paraissaient intelligents, capables de reconnaître une bienfaitrice. J’aimais cet instant de la vie quotidienne, ô ! combien banal, mais tellement reposant par sa simplicité. Pendant ce moment, absorbée à m’intéresser à l’autre même à un oiseau qui picorait son grain, c’était oublier le passé, c’était ignorer l’avenir, c’était presque un moment de bonheur parfait. « Un temps où l’on s’oublie, où l’on oublie sa place dans l’existence par rapport aux autres. Un temps furtif où l’on ne réfléchit plus, où l’on ne pense plus, où l’on se sent unique dans un monde que l’on voudrait presque parfait, loin de l’adversité, de l’inégalité sociale, de ce qui peut troubler une personne quel que soit son âge. »
Pour clore l’après-midi qui ressemblait à tant d’autres lorsque l’on n’avait pas école, nous fîmes un détour chez la boulangère qui se situait à quelques pas de chez nous. Pendant que je jetai mon dévolu sur les petites boîtes de réglisse à l’aspect d’un dé rectangulaire à cinq centimes la boîte, mes sœurs s’attardèrent sur le choix des malabars dans l’espoir de trouver le chewing-gum qui comporterait le papier avec l’inscription « gagnant ». Cela, leur aurait permis d’en rajouter gratuitement. Ce fût le seul réel plaisir de la journée.
Quant à moi, tout au long de mon existence, le réglisse restera le symbole qui rappellera mon enfance chargée d’une valeur affective. Celle que l’on a généralement pour l’endroit où l’on est née malgré les vicissitudes de la vie, où l’on a vécu. Le temps m’apprit que l’on ne coupait jamais complètement le cordon ombilical avec son pays natal.
Au retour à la maison, je m’installai sur le grand lit parental. Je pris ma poupée préférée dans mes bras. Je la câlinais en lui offrant les gorgées de lait imaginaire que mon biberon magique faisait disparaître dans la tétine à chaque fois que je l’inclinais. J’avais une variété de jouet qu’une bienfaitrice nous avait apportée. Perdue, dans mon insouciance enfantine, ignorant le monde des adultes, je berçais, berçais ma poupée, me rappelant peut-être inconsciemment le meilleur moment de parfaite plénitude, celui quand j’étais un bébé.
CHAPITRE II
Derrière la fenêtre de la chambre, je regardais le ciel que le mauvais temps rendait gris et que l'épais nuage de fumée rendait encore plus sombre. Une sonnerie stridente m'éveilla de ma torpeur. C'était la sirène de l'usine. La rude journée avait pris fin pour les ouvriers, papa allait bientôt rentrer au bercail.
Le soir, nous étions tous réunis autour de la grande table rectangulaire. Nous attendions que maman serve le repas, des spaghettis au beurre. D'un seul regard, on pouvait embrasser ce qui composait la demeure d'une famille de neuf personnes. Deux pièces et une étroite cuisine où seul un adulte pouvait circuler.
Mes parents partageaient leur chambre avec mon frère et une partie de mes sœurs. L'autre pièce était la salle à manger. Elle servait aussi de chambre à coucher pour le reste de la famille. La grande table, les chaises, le fourneau et les matelas empilés l'un sur l'autre, n'encombraient pas tellement, ou plutôt, on s'y était habitué. Pendant que chacun savourait sa ration de pâtes, papa en profita pour discuter un peu de choses sérieuses avec ma mère.
- Femme ! J'ai une nouvelle importante à te confier.
- Tu prends un air sérieux, j'ai peur, qu'y a-t-il ?
- Demain nos frères fidaï doivent passer chez nous, ils ont besoin de se réunir, le seul endroit est ici.
- Nous prenons trop de risques, j'ai des enfants que je dois protéger. A chaque fois qu'ils viennent, la patronne de l'immeuble me crible de questions. Je lui explique qu'ils sont mes frères, des oncles et même des cousins. Elle me répond de son air narquois : « en voilà une bien grande famille ! »
- Tu ne resteras pas à la maison. Demain, tu te débrouilleras pour aller quelque part avec les enfants, beaucoup de frères et sœurs sacrifient leur vie pour une future patrie libre, il n'y a pas de raison que nous agissions autrement.
La discussion prit fin puisque papa débita ces dernières paroles d'un ton péremptoire. Après avoir débarrassé la table et mis de l'ordre dans les pièces, tout le monde rejoignit sa place pour dormir. Il m'arrivait parfois de me réveiller tôt mais ce jour-là, ce fut à l'aube que j'entrouvris les paupières. Papa faisait la prière. Il m'était agréable de l'entendre réciter les versets du Coran même si je n'en comprenais pas le sens.
La foi en Dieu s'était éveillée en moi, je ne sais comment ? Papa et maman parlaient rarement de ces choses. Ils pratiquaient la religion musulmane, une religion différente de celle des gens de ce pays qui n'était pas le nôtre.
En hiver, j'admirais dans les vitrines, les sapins de Noël ornés de guirlandes, aux multiples couleurs qui scintillaient, les jouets et un tas de jolies choses que mes yeux dévoraient. Nous, nous n'avions pas le droit de fêter Noël, ni Pâques, d'ailleurs ! Papa disait que notre fête existait : l'Aïd. Ce jour là, chaque famille devait sacrifier selon ses moyens, un mouton. Les femmes mettaient du henné aux mains et aux pieds, quant aux enfants, ils étaient vêtus de vêtements neufs, des pétards ainsi que des pièces d'argent tintaient dans leurs poches.
Où sont ces merveilles que je ne pouvais connaître sur une terre d'exil ? Etions-nous des enfants sans religion ? Pourtant ! Nous étions une parcelle de vie qui s'était détachée d'un tout qui s'appelle : l'Algérie !
Une Algérie, lointaine ! Inconnue pour nous qui étions nées ailleurs.
Le dimanche matin alors que chacun vaquait à ses occupations, nous avions décidé ma sœur aînée et moi-même de jouer à l'infirmière et au malade. Comme j'étais la patiente, elle m'allongea sur le grand lit en faisant mine de me border quand, subitement ! Sa main heurta quelque chose. Entre le matelas et le sommier se trouvaient plusieurs liasses de billets.
- Regarde ! Me dit-elle en écarquillant ses yeux. J'appelai maman qui accourut aussitôt.
- Petites folles ! S’exclama-t-elle, Ne dites rien à personne, allez donc jouer dehors.
Pour moi, l'incident était clos, mais Samia avait la langue bien pendue. Elle raconta sa découverte à une vieille voisine qui vivait seule. Elisabeth gavait ma sœur de friandises à chaque fois qu'elle en avait l'occasion. Samia bavarde mais aussi gourmande, ne voulait pas partager les crottes de chocolat. Ce fût alors, une bonne raison de me venger. J'en informai ma mère qui s'affola très vite. Heureusement, c'était jour de congé. Papa était à la maison. Il se précipita vers le lit et remplit un sachet en plastique de toutes les liasses de billets. Il descendit dans la cave, muni d'une bougie. La cave représentait pour moi une grande tombe. Elle était divisée en plusieurs cases qui servaient à conserver le charbon de chaque locataire. Ma curiosité face à la panique de mes parents fut satisfaite. Une heure à peine s'était écoulée que nous entendîmes frapper à la porte. La police française était là, menaçante ! Ils accusaient mes parents de complicité avec les frères.
"Complicité !« Disaient-ils, pour avoir dissimulé de l'argent qui aurait servi à un mauvais usage, tandis que mon père expliquait que ma sœur avait beaucoup d'imagination, ils mirent la maison sens dessus-dessous mais, sans résultats. Sils retournèrent notre charbon dans l'espoir de retrouver la pièce à conviction qui eût aidé à l’inculpation de mes parents, ils épargnèrent celui des autres locataires. Papa eût la merveilleuse idée d'enfouir le pécule dans le charbon d'un de nos voisins. Les policiers partirent bredouilles. Tout le monde était soulagé. Samia avait compris que sa langue avait failli compromettre une famille, la sienne !
Plus tard, nous sûmes que les émigrés avaient eu en France, un rôle important dans le combat contre le colonialisme. Il y avait la logistique comme l’achat des armes et l’argent que les militants dissimulaient dans les caves. Les réunions secrètes ça et là entre des personnes assoiffées de liberté et de dignité pour le pays dont elles se sentaient spoliées. On les appelait : les Fidaïs. Ces combattants du colonialisme étaient aussi des femmes. Elles apportaient leur contribution sous différentes formes selon leurs moyens pour atteindre le but final, une Algérie libérée de toute occupation étrangère.
CHAPITRE III
Les jours de semaine se ressemblaient tous. Ce qui marquait certains instants de notre vie quotidienne, c'était la cohue et les bousculades dans le métro. La course éternelle pour ce pain qui devait faire pousser et entretenir chaque être d'une famille. Dans l'esprit de chaque émigré, une phrase était inoubliable, lutter sans relâche pour survivre. Si Paris avait une figure ! Nous la voyions uniquement le dimanche par certaines places aménagées pour le marché ainsi que les parcs et jardins dotés de différents jeux d'attraction. Souvent, près d'une église ou sur le trottoir d'une rue, le tableau d'un accordéoniste aveugle accrochait notre regard. Les airs joyeux qu'il jouait nous remplissaient de nostalgie. Cependant, pour les touristes, Paris était désignée par la cathédrale, la tour Eiffel, le Moulin Rouge ou la place de l'Opéra, etc. Pour nous, Paris n'avait pas la même signification. La ville avait un autre visage. Elle paraissait moins lumineuse, moins indulgente, mystérieuse et sans attrait. Par une nuit d'hiver, alors que le tonnerre grondait dans le ciel, je m'installai près de mon père. Je lui demandai de me parler de son pays. S'il ne me répondit pas d'une manière évasive, il paraissait lointain. Je lisais sur son visage un chagrin dont je ne saisissais pas le sens.
- L'Algérie ! On ne la raconte pas. Les mots ne rapportent pas fidèlement ce que les yeux ont vu ou ce que le cœur a ressenti. L’Algérie ! mon enfant, c'est une terre dominée par un beau soleil et un magnifique ciel bleu, si bleu, qu'il peut débarrasser une personne d'un peu de ses soucis. C'est aussi une douce chaleur qui réchauffe et une étincelle d'espoir qui fait frémir mon cœur. L'Algérie ! c’est aussi la force, celle qu'engendre l'union des frères et sœurs d'une même patrie. Quand tu grandiras, tu comprendras.
Si pour mon père, l'Algérie était une réalité, pour moi elle avait l'aspect d'un songe. Après le récit de quelques anecdotes, je compris combien mon père aimait la vie. Beaucoup de gens avaient une prédilection pour certains plaisirs que papa ignorait. C'était son choix. Il exécrait l'alcool, les boîtes de nuit ou bien perdre son temps trop souvent dans un bar. Pour lui, les artifices qu'offre une ville sont un piège pour oublier, peut-être pour oublier le court temps d'une vie.
La vie ! comment la définir ? Par les battements d'un cœur ? Non ! Elle a différentes formes.
Imaginez un soleil qui ne se lèverait plus. Une lune ou des étoiles sans éclat. Une terre stérile, une rose fanée ou encore un arbre sans feuilles. La seule éventualité d'une fin par la mort, définit la vie. Papa aime le contact de la terre mouillée par la pluie ainsi que l'odeur qui en émane car pour lui elle respire. Il aime voir son figuier pousser et sentir le soleil le taquiner de ses rayons lumineux. Il adore le piaillement des oiseaux, le crépitement de la pluie sur les toits de tuiles ou le beuglement d'une vache qui vêle un superbe veau. Là, où la vie s'infiltre, naît un plaisir intarissable. 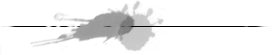
Réagir à ce texte (e-mail à l'auteur) :
|

