21/11/2002 - Chahrazed Labiod
Retrouvailles - Chapitres 4 à 7
CHAPITRE IV
Quant à moi, je me remémore un de mes meilleurs moments de plaisir, un souvenir empreint de couleur, d'une couleur vive. En sortant de l'école, je vis ma mère près du portail. Elle m'attendait toujours après la classe. La forte circulation des voitures encombrait les routes. Elle m'acheta un gâteau en guise de goûter. Je fus surprise de constater que nous ne nous dirigeâmes point vers la maison. Nous pénétrâmes dans un magasin de vêtements. Maman jeta son dévolu sur une robe orange avec deux grandes poches à l'avant et de gros boutons blancs à l'arrière, le long de la colonne vertébrale. La teinte du vêtement m'avait frappée. Une fois dehors, je regardais ma mère avec fierté. Elle était belle, son allure avait changé. Elle s'était toujours résignée à porter du linge qu'elle recevait de certaines œuvres de bienfaisance. Le faible revenu de mon père, le nombre élevé des enfants, privaient ma mère de telles gâteries.
De retour à la maison pendant que maman vaquait à ses occupations, je me mis à la fenêtre, le regard perdu dans la grisaille du ciel parisien. Je scrutais les nuages. Ils se déplaçaient lentement, leurs formes bizarres évoquaient pour moi des êtres étranges. Par le regard, j’avais l’impression de communiquer avec eux. J’inventais des histoires au gré de mon imagination, ils en étaient les personnages. Tout à coup ! J’entendis des cris qui provenaient de l'extérieur. J'ouvris la fenêtre. Je vis à l'étage du dessous, la propriétaire de l'immeuble dans tous ses états. Elle hurlait d'une manière tellement hystérique que j'en eus des frissons. Elle me fit signe. Je compris qu'elle voulait s'adresser à ma mère. Je m'accrochais à sa robe puis je la suivis. Nous nous heurtâmes nez à nez avec la Polonaise. Elle se tenait bien droite dans les escaliers. Elle nous toisa de son air hautain et dédaigneux. Elle reprocha à maman d'avoir renversé quelques gouttes de blanc d'Espagne sur ses plantes qui se trouvaient sur son balcon.
Nous ignorions comment ce produit qui servait à blanchir les chaussures, était arrivé là-bas. Maman s'excusa gauchement. Elle avait ce complexe de certains émigrés qui employaient mal la langue étrangère. La grande victime n'était pas satisfaite de l'attitude désolée de maman. Elle nous traita d'abord de gens primitifs et sans éducation. La vilaine dame gifla brutalement ma mère qui n'était pas disposée à se laisser humilier injustement en ripostant. Avec habileté, elle saisit son adversaire par sa chevelure et la fit tournoyer comme une toupie. La malheureuse se débattait en hurlant. Son mari accourut ainsi que mon père. Le Polonais ordonna d'arrêter la bagarre. Papa fit de même, mais le spectacle lui plut tellement qu'il se ravisa en ordonnant à mère dans notre langue, de lui asséner une fameuse correction. Les deux femmes cessèrent leurs manœuvres belliqueuses. Maman était victorieuse. L'étranger aida sa conjointe à se relever. Cette dernière titubait comme une personne ivre. D'un geste frénétique, elle essaya de rétablir son chignon qui n'en était plus un. Elle était en piteux état. Maman rayonnait de satisfaction malgré sa robe fripée.
En triomphant de l’assaut féminin, ma mère avait préservé sa dignité. Comment s’imposer parmi les étrangers lorsque la personne exilée était analphabète, ignorant les règles qui régissaient une société dite civilisée et moderne ? Avec subtilité, parfois avec brutalité, les puissants bien lotis dominaient ou écartaient les gens de catégories sociales prolétaires. Ainsi, ils devenaient des marginalisés, pour d’autres, ils étaient qualifiés d’inadaptés. Quand le plus fort rejetait le plus faible pour différentes raisons : économiques, culturelles ou même religieuses, on disait du plus faible qu’il ne s’intégrait pas. Par analogie à ce petit incident, beaucoup plus tard à la télévision via le satellite, j’entendis sur des chaînes françaises, le mot « intégration » à propos des « beurs ».
Comment faut-il justifier le refus de ces enfants immigrés héritiers de deux cultures, opposées par certains de leurs aspects, complémentaires par d’autres ?
Quel subterfuge ! Pour légitimer leur exclusion, « Intégration » est un terme subtil empreint de diplomatie ou d’hypocrisie judicieuse pour exprimer le rejet de l’autre. Je le remplacerais volontiers par le terme « acceptation » des « beurs ». Les xénophobes ont un problème, accepter l’autre, chaque « beur » dans son entier. Les « beurs » sont des êtres humains à part entière, intelligents, sensibles, qui s’adaptent automatiquement au sein de la société où ils grandissent.
Néanmoins ! A cette période, il existait des voisines dont le niveau de vie était honorable. Malgré leur aisance matérielle, elles étaient d’une gentillesse et d’un humanisme tels à l’égard des étrangers que l’on aurait pu les confondre avec des compatriotes. Je pensais à madame Pasquel, la voisine du 5ème étage, le dernier de notre immeuble. Elle avait appris à ma mère à cuisiner de bons petits plats français qui ne contenaient pas de porc par respect de la tradition musulmane. Il y avait aussi madame Vadou qui nous coupait les cheveux de temps à autre, cela nous évitait des dépenses chez le coiffeur. Quant à Giselle la voisine du premier, elle avait confectionné à Samia, un maillot de bain pour ses cours de natation à l’école. Mais l’un des meilleurs souvenirs, c’était quand maman avait acheté du tissu bon marché. Giselle nous avait fait des robes bouffantes pour la fête de fin d’année scolaire. Les robes gonflaient à chaque fois que nous tournions comme des toupies. Nous étions fières comme nos petites camarades, nos robes étaient jolies, c’était tellement important à notre âge. La France était en guerre contre l’Algérie, cependant ! Des Françaises tendaient une main amicale à cette femme du camp ennemi.
Dans cet immeuble, vivaient côte à côte des gens distants, certains étaient indifférents, d’autres hospitaliers, serviables et dotés d’une chaleur humaine qui réconfortait les plus faibles.
CHAPITRE V
Bien que ma mère avait une grande importance, la personne qui aura eu le plus d’influence sur ma personnalité en construction et qui déteignit sur moi, c’était ma sœur cadette pour qui j’avais une préférence. Je la voyais rarement. Ma famille disait que Kheira me ressemblait beaucoup. Deux femmes célibataires qui vivaient ensemble près de chez nous, firent la connaissance de mon père. Il les prit en sympathie puis disait-il, elles étaient très braves, au point que Kheira passait la majorité de son temps auprès d'elles. Elles l'avaient prise, selon leur expression, lorsque Kheira était un petit avorton de trois ans. C'était, je crois un soulagement pour mes parents qui ne pouvaient pas nourrir correctement toutes nos bouches.
De temps à autre, Kheira revenait au bercail. Je la voyais changer de plus en plus par son comportement. Elle adoptait les manières d’une petite demoiselle raffinée. Elle n’avait pas des écarts de langage. L’argot ne faisait presque jamais partie de son vocabulaire. A table, elle maniait mieux que nous tous, le couteau et la fourchette. Involontairement, étant plus jeune, je copiais tout ce qu’elle faisait pour devenir comme elle. Je l’admirais beaucoup. Elle savait tant de choses que j’ignorais, on appelait cela, de la culture. Les deux grandes amies lui donnaient aussi des leçons de savoir-vivre. Je récoltais quelques miettes de ses connaissances. Quelquefois, je l’accompagnai chez Pauline. Un jour, je fus invitée chez elle pour le repas de Noël. Ce qui me frappa, c’était l’odeur qui se répandait dans leur demeure. Cela provenait du parquet bien ciré. Il fallait toujours enfiler des patins en tissu pour ne pas salir le sol reluisant. Je m’amusais à glisser comme sur une patinoire. Jeannine avait libéré de la cage, un couple de colombes. Elles étaient d’une blancheur immaculée. Quand Pauline appelait une des deux par son nom, elle venait se poser sur son épaule. Les oiseaux étaient apprivoisés. J’aimais leur présence qui était agréable et tant d’autres choses. Je m’émerveillais devant le sapin de Noël, habillé de sa plus belle parure. Des étoiles qui scintillaient, des boules de toutes les couleurs, des petites lumières et des guirlandes constituaient l’ornement du fameux sapin. Kheira m’emmena voir un endroit de la maison qui avait ce jour-là une importance spéciale. Sur un meuble en bois, je ne sais plus lequel, c’est si lointain que certains détails m’échappent, elles avaient dressé un décor en miniature qu’elles appelaient la crèche. Celle- ci représentait une étable, à l’intérieur, des moutons faits avec de la mie de pain. Il y avait d’autres animaux en plastique : des vaches et un âne. Parmi ce bétail en joujou, se trouvait un bébé magnifique qui se prénommait « Jésus » m’avait-elle dit. Il y avait d’autres personnages dont Marie la mère de Jésus, des bergers ainsi que des Anges. Les bébés aux boucles d’or, me fascinaient. Ils étaient nus avec des ailes accrochées à leurs dos, d’après Kheira, celles-ci leurs donnaient le pouvoir de s’envoler. Ces protecteurs de Jésus, veillaient sur lui. En réalité je ne comprenais rien à la religion. Personne ne m’avait jamais expliqué ces choses-là. Je savais simplement que Dieu existait, qu’il fallait l’aimer et le craindre lorsque l’on faisait des bêtises. Il y avait le mal et le bien. C’était ce que je pouvais retenir à mon âge. Je n’étais ni chrétienne, ni musulmane dans ma tête enfantine. J’étais tiraillée entre deux cultures, deux religions. Celles du pays où je vivais, où j’étais née et celles de mes parents. Pendant leurs prières, chrétiens et musulmans invoquent le même Dieu n’est-ce pas cela l’essentiel ?
Quand vint le moment du repas, un petit incident ternit cet instant convivial qui nous rassemblait. Après avoir dégusté un morceau de dinde, voilà que Pauline insista très fort pour que je mange un morceau d’une grande saucisse de couleur blanche. Je n’avais auparavant jamais goutté à cet aliment dont la vue m’écœurait. C’était du boudin. Pauline, cette femme de caractère, m’impressionnait drôlement. Elle me disait qu’un bon croyant ne devait pas rechigner devant la nourriture que Dieu lui accordait. En réponse à ses recommandations, je me mis à sangloter. Au dessert, Pauline se fit pardonner sa douce tyrannie en m’offrant un gros morceau de bûche. Le gâteau me fit oublier mon petit chagrin précédent. Je fus épargnée par le supplice en n’ingurgitant pas la chose qui était étrangère pour moi.
Quelques années passèrent, les dames déménagèrent à la campagne. Kheira les accompagna. J'ignorais quel était leur moyen de subsistance, néanmoins, elles vivaient à leur aise. Pauline et Jeannine s'occupaient d’œuvres de charité. Elles étaient de bonnes chrétiennes. Pauline avait fait des études à la Sorbonne. Après une série de problèmes de santé, elle devint impotente. Pauline se faisait désormais aider par Jeannine pour vivre le plus normalement possible. Elles créèrent un centre pour adultes handicapés. Elles le dirigèrent remarquablement. Elles s'adonnèrent à leur tâche avec beaucoup de ferveur. Nous fûmes, papa et moi, invités à la campagne pour un déjeuner auprès de cette famille factice que la destinée avait réunie. Nous arrivâmes vers onze heures chez les demoiselles. Je revois encore Kheira dans le jardin, un sécateur dans la main. Habilement, elle coupait les tiges des lilas qu'elle devait rassembler pour en faire un énorme bouquet.
Son petit visage rayonnait de bonheur. Elle menait un train de vie dont je me fis plus tard une idée précise. Ma sœur m'invita à la rejoindre dans ce qu'elle osait appeler son salon. C'était une gamine comme moi d'ailleurs mais, elle possédait déjà les bonnes manières des adultes. Une partie du grand garage était aménagée en lieu personnel où Kheira pouvait inviter ses différentes poupées. Elle était généreuse car elle joua gentiment avec moi en me prêtant ses magnifiques jouets. Elle me fit visiter sa chambre qui se trouvait au premier. Elle possédait une grande pièce rien que pour elle, quand moi je devais la partager avec les miens. Elle me fit des propos sur l'amour du prochain. En plus du confort dont elle jouissait, elle recevait les conseils de ces bonnes chrétiennes sans en être une, elle-même. Avant de les quitter, Kheira m'offrit quelques pièces d'argent qu'elle gardait dans sa tirelire ainsi qu'un paquet de biscuits qui devait agrémenter plus tard mon voyage dans le train. Dans la rue, quand nous marchions, papa me tenait la main. Sa main était légèrement rugueuse mais puissante. A son contact, je ressentis un grand réconfort, un bien-être sans égal que je nommerai l'amour, celui d'un père et de son enfant. C’était un plaisir différent de celui qu'on prodiguait à ma sœur. En plus du confort matériel qui n'était pas négligeable, les deux femmes avaient une petite nord-africaine qui leur tenait compagnie.
Y-a-t-il plus beaux diamants que les yeux d'un enfant dont le pétillement rappelle la splendeur des joyaux ? Devant tant de tentation matérielle, les yeux encore pleins d'innocence de Kheira brillaient de satisfaction. Pour les deux femmes, qu'y avait-il de plus stimulant et de plus attrayant comme ornement dans leur maison que les ébats d'un enfant ? Quand Kheira revenait au bercail, elle était triste. Ses bienfaitrices ne lui permettaient jamais de ramener un seul de ses jouets à la maison familiale. Elle était démunie de tout comme Cendrillon après le bal de minuit. Selon ses amies, il était impérieux qu'elle ne s'encombra pas de ses jouets. Grâce à cet appât, Kheira sollicitait très vite de repartir chez ses bienfaitrices. Si ma mère affichait un visage serein, j’y percevais les traces d'une petite amertume. La peine que l'on subit lors d’un échec après un défi. Pauline était « la maman préférée » de Kheira.
CHAPITRE VI
Un jour de l'année mille neuf cent soixante deux, nous prîmes le bateau pour l’Algérie. C’était la première fois que je faisais un tel voyage. J'avais huit ans. Ce qui me marqua le plus lors de la traversée, c'était le coucher du soleil. Je le voyais descendre lentement. L’astre d’un rouge flamboyant comme un brasier s’éteignait progressivement pour être englouti par la mer couleur encre. J’étais sur le pont et m’accrochais au bastingage. Je regardais cette vue imprenable de cette superbe mer légèrement en fureur. Je sentais sa supériorité par son immensité et par la force impitoyable de ses vagues qui m’impressionnaient terriblement. Des rumeurs circulaient dans le bateau. Il s’agissait de fouille des voyageurs par des gens qui assuraient la sécurité du bateau. Papa avait eu en sa possession, un papier certifiant sa contribution avec les frères pour la libération de son pays. A la vue de l'équipage avec leur uniforme marin, il eut un sursaut. Des sueurs froides avaient perlé sur son front. Son cœur battait la chamade. Sans réfléchir, guidé par la peur, il jeta par dessus bord après l'avoir déchirée, la preuve formelle de son patriotisme. C'était la dernière fois que son être tout entier fût secoué par ce terrible mal que l'on nomme la peur. Celle-ci donne souvent à une personne le sentiment amer d'être un débris ou une loque humaine. La peur déshabille parfois l’être humain de toute dignité en le poussant à des actes répréhensibles : la traîtrise, le mensonge, le crime, la haine de soi-même et des autres. Elle mène au désespoir et à la destruction des individus.
Je fis la connaissance de mon pays un laps de temps mais qui ne me permit pas d'avoir une appréciation définitive et objective de ce dernier.
Le pays était en fête. Une frénésie touchait toute la population. Sur toutes les maisons, les gens avaient arboré le drapeau de leur nation : enfin ! Libre du joug colonial ! Tout ce que je voyais ou entendais me stimulait : « Le youyou » perçant des femmes, le rire des enfants, des chants révolutionnaires résonnaient dans les rues. Des camions chargés à craquer pèle-mêle de personnes de tout âge qui brandissaient fièrement des grands et petits drapeaux. Le peuple scandait de toutes ses forces : « Vive l' Algérie ! »
Sur les visages tannés des vieillards, il y avait cette lueur d'espoir de lendemains meilleurs. Tous les Algériens et toutes les Algériennes ne faisaient ce jour-là, qu'un seul être. Ils étaient tous animés du même sentiment de liberté, de fraternité et de gloire. Mais, la reine de ce jour ! Soyeuse, fière, balançant librement dans l’air qui la faisait danser, c’était ce morceau de tissu, vert, blanc, rouge, marqué d’une lune et d’une étoile : le drapeau de l’Algérie.
Je me fondis dans la douce folie collective, enivrée par l’élixir de la joie déferlante qui me fit sentir progressivement que j’appartenais à ce pays et inversement. Le symbole suprême de cette glorieuse nation me fit comprendre enfin mon erreur sur l’histoire de l’homme aux babouches. Pourquoi l’homme aux babouches ? Au début du récit, je disais que je me sentais différente des Parisiens mais sans savoir avec exactitude pourquoi. La notion des mots : nation, nationalité sont des termes compliqués pour les enfants. J’ai toujours pensé qu’il y avait des catégories de gens pour tel détail, telle raison, comme il y aurait des catégories de chiens, de volaille, etc. : des bergers, des bouledogues, des dindes ou des canards, etc. peu importe.
Un jour en classe, pendant la lecture, nous lûmes une histoire concernant les Hindous. Sur la feuille du livre était illustrée un hindou dans sa tenue traditionnelle. Ses chaussures étaient des babouches. Mon père en possédait une paire qu’il mettait en rentrant du travail. Je fis le lien avec l’image. Désormais, je crus que j’appartenais à la catégorie de gens que l’on appelait « hindou » à cause de la paire de babouches. Le détail vestimentaire m’avait induite en erreur, je compris, enfin !
Après avoir partagé tant de bonheur, nous quittâmes l’Algérie le cœur léger.
CHAPITRE VII
Quelques années passèrent depuis notre retour après la fête de l’indépendance de l’Algérie. Maman avait évoqué l’effet bénéfique que lui avait fait son séjour sur sa terre natale. Une idée avait germé dans sa tête. Elle voulait quitter définitivement la France pour être près de sa famille et de ses anciennes amies. Elle souffrait de solitude sans compter la nostalgie pour le mode de vie de ses ancêtres. Elle aurait voulu s’asseoir en tailleur, sur une peau de mouton dans une courette ou dans un jardin à l’ombre d’un arbre dégustant du petit lait avec de la galette bien chaude. Elle ne cessait de répéter que les chaises étaient un instrument de torture pour ses jambes. Pourtant, sur cette terre de l’exil, elle avait appris à s’aimer puisque sa condition de femme ne l’empêchait pas d’évoluer avec le temps. Elle connaissait ses capacités, ses limites et son désir de progresser. Sans être allée à l’école, elle avait appris le français. Elle pouvait compter et même utiliser le thermomètre quand nous étions malades. Elle savait voyager seule en métro quand cela était nécessaire. N’était-ce pas une performance pour une analphabète qui ne connaissait jadis que les corvées du foyer conjugal ? Faire les commissions ou ramener les enfants de l’école étaient pour elle beaucoup plus une distraction qu’une contrainte. Surtout ! elle avait appris à prendre soin de sa personne sans se culpabiliser en croyant que c’était inutile ou mal de bien se sentir dans son corps. Elle ne cachait plus ses cheveux sous un foulard. Ses beaux cheveux couleur de jais étaient si noirs qu’ils avaient des reflets bleus. Elle les enroulait derrière sa tête sous forme de tresses qu’elle retenait avec de jolis petits peignes. Une touche discrète de maquillage donnait de l’éclat à son visage. Une fois, je la vis avec un tailleur gris qui lui donnait presque l’élégance des belles dames des années cinquante. Maman avait découvert qu’elle était un être humain à part entière avec ses désirs, ses rêves et ses aspirations. Au tréfonds d’elle-même, elle savait ce qu’elle répugnait le plus, l’ignorance des choses. Ces choses essentielles de la vie qui permettent à une personne d’évoluer. Le rôle de la femme bien souvent, se limite à la reproduction de la race humaine, ce qui est insuffisant pour l’édification d’un pays même si c’est glorifiant de donner la vie. L’échec et la hantise pour une femme était de ne pouvoir mettre au monde un enfant de sexe masculin. Maman eut cinq filles et un seul mâle. Quelle importance sur cette terre étrangère où un enfant restait un enfant quel qu’il fût, garçon ou fille !
Le vœu de ma mère se réalisa désormais. Les préparatifs pour le grand départ avaient commencé. Mes sœurs et moi-même étions tellement heureuses de connaître un pays qui serait enfin le nôtre. Papa emballa dans des malles, tout ce qui pouvait servir en Algérie : du linge, des ustensiles de cuisine, mais aucun meuble. Je glissais furtivement entre les vêtements, des jouets qui m'appartenaient ainsi que des poupées. Pour papa, il était inutile d'encombrer les malles de choses superficielles. La patronne de l'immeuble lui avait permis d'utiliser sa courette pour y fabriquer une grande caisse afin d'y ranger différentes choses nécessaires pour notre nouvelle demeure. Ce jour-là, il pleuvait très fort. J'étais derrière la fenêtre de la chambre, le nez collé contre la vitre. Bien à l'abri, j'observais mon père s'acharner contre les planches et les clous pour venir à bout de son ouvrage. Sa chemise était plaquée contre sa peau tellement il était trempé. Il avait préféré économiser quelques sous à l'achat d'une autre malle. Il avait soixante six ans. Quelques années auparavant, il avait bénéficié d'un agrément de la préfecture de Paris. Cela lui avait permis de vendre des fruits et des légumes au marché des Halles. Son petit commerce lui fut salutaire. Il put thésauriser assez d'argent pour quitter un pays où il ne voulait pas mourir. A son âge, il ne pouvait être sûr du temps qu'il lui restait à vivre. Son souci était de s'installer rapidement sur sa terre natale afin de devancer l'inéluctable fin humaine et avoir la chance d'être enterré auprès des siens. En France, il s'était usé au travail. D'abord la mine, mais il n'avait pas pu tenir plus de six mois tellement le travail était pénible. Il avait préféré son boulot de manœuvre dans les usines. Pour terminer sa carrière d'ouvrier, il avait fallu à un certain âge, charger et décharger les lourds cageots. Son étalage était une charrette qu'il déplaçait à sa guise. Le soir, il tractait sa boutique ambulante du quatorzième arrondissement jusqu'au quinzième afin de l’y abriter pour la nuit dans un hangar. C’était là qu’il rangeait sa marchandise. Lorsqu’il rentrait à la maison après une longue journée à satisfaire des clients parfois capricieux, il était pâle avec des lèvres violacées. Il avait déjà subi deux interventions chirurgicales, je crois qu'il n'avait pas mangé assez de viande rouge pour retrouver ses forces de jadis. Le combat pour la survie de sa famille avait été perpétuel. Papa était un Algérien issu d'un milieu qui s'exprimait en kabyle. Différentes familles se regroupaient en tribu. La sienne était connue pour son sens de l'honneur et du respect de la dignité humaine. Grand-père était le sage du village. Il était généreux, humble et droit.
Lorsqu'un voyageur ou un pauvre homme était de passage dans leur village et qu'il n'avait pas où loger, mon aïeul le conviait pour passer la nuit. Ce soir-là, il égorgeait un coq en l'honneur de ce qu'il appelait l’invité de Dieu. Une table basse ou « méïda » était bien garnie : du petit lait, du couscous accompagné d'une bonne sauce avec divers légumes et enfin des figues sèches en guise de dessert. Un véritable festin était partagé avec le malheureux. La tradition enseignait en premier, le sens de l'hospitalité. Quand il apprenait le décès d'une personne qui habitait l'agglomération et que celle-ci était indigente, grand-père égorgeait un mouton et l'offrait à la famille du défunt pour le repas funéraire.
A cette époque, pourtant archaïque, les gens avaient le sens de l’hospitalité et du partage. La modernité a ses avantages mais aussi ses inconvénients. La société moderne émousse la sensibilité de l'être humain et fait de lui un individualiste.
Après avoir fait nos adieux aux amis et aux voisins, nous fûmes prêts pour le grand départ. Mes sœurs et moi-même étions heureuses de découvrir d'autres horizons. Nous fîmes le trajet Paris-Marseille en train. Ce fût long. Afin d'agrémenter notre voyage, Samia sortit de sa poche, un jeu de cartes. A leur vue, Papa les prit et les déchira. Nous pensâmes à un geste d'hostilité, à une quelconque colère. Ce n’était pas la première fois qu'il nous voyait jouer ainsi. Plus tard, je compris que c'était le début d'une série d'interdits dont étaient victimes les filles ainsi que les femmes du pays. Nous terminâmes le périple en bateau. Alger la blanche était chaleureuse, rayonnante et accueillante. Les Algérois affichaient de la nonchalance et une certaine douceur de vivre. Nous fîmes la connaissance d'une partie de la famille, puisque d'autres oncles et tantes vivaient en dehors d'Alger particulièrement en petite Kabylie.
Les cousines avec qui nous avions fait connaissance, maîtrisaient aussi bien la langue kabyle que l'arabe et le français. Maman rayonnait de bonheur. Elle était comblée de se retrouver auprès des siens. Elle avait tellement de choses à raconter à sa sœur Tassadit que la soirée devait être longue. C’était ma première nuit en Algérie, mon vrai pays. J'avais laissé ma terre natale derrière moi. Sur mon matelas avant de sombrer dans un sommeil réparateur, je réalisais que je n'allais plus revoir le bercail de ma petite enfance. J'avais quitté mes repères : mon quartier, mes camarades, mon école, la boulangère chez qui j'achetais régulièrement le pain ainsi que le réglisse que j'adorais. Je me disais alors : « Je n'entendrai plus les cloches de l'église sonner ses coups le dimanche. A l'angle de la rue près de notre immeuble, un gentil petit bistrot où régnait toujours une atmosphère animée et bon enfant, donnait de la gaieté au quartier. Je n'écouterai plus les boules de billard s'entrechoquer. Je ne verrai plus les lumières de toutes les couleurs qui jaillissaient d'instruments de jeu que je ne saurais nommer mais qui me fascinaient. Je ne percevrai plus dans le calme de la nuit, le bruit insolite des hauts talons aiguilles percuter le pavé ». Je regrettais déjà de ne plus voir mes films préférés : « Thierry la fronde, Ivanhoé, Bayard etc. » Avant de fermer mes paupières qui commençaient à s'alourdir, je revoyais Nounours et le marchand de sable dans « Bonne nuit les petits. » Tout ce qui faisait partie de mon monde d'enfant s'était désormais évanoui comme un songe. « À présent » me dis-je. « Que me réserve cette nouvelle terre que l'on nomme l'Algérie ? » A douze ans, on est tiraillé entre l'insouciance des enfants et le sérieux des adultes. « Avec le temps, je saurai ce que je voudrais savoir… ! » 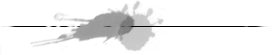
Réagir à ce texte (e-mail à l'auteur) :
|

