21/11/2002 - Chahrazed Labiod
Retrouvailles - Chapitres 8 à 10
CHAPITRE VIII
Papa avait commencé la construction de notre maison sur le lopin de terre que le frère de mon grand-père maternel lui avait donné. Un oncle qui habitait près de l'oued de la Soummam nous avait offert l'hospitalité pour vivre dans une partie de sa grande demeure jusqu'à ce que notre logis soit prêt. Nous étions en mille neuf cent soixante six. Ce qui me frappait le plus, c'était les liens fraternels qu'entretenaient tous les voisins. Tout le monde se sentait concerné par le bonheur ou les peines de chacun d'entre eux. Lors des longues soirées d'été, nous recevions de la famille et des amis, nous leur offrions des boissons fraîches ainsi que des fruits. Quelquefois, nous rendions visite aux gens pour qui mes parents avaient de la sympathie. Les routes n'étaient pas encore construites. Souvent, sur le chemin de terre qui menait au village, nous faisions la rencontre de poules, de dindes ou d'un gentil petit âne tractant une charrette chargée de fûts ou de vieux bidons remplis d'eau. Il n'était pas rare de croiser des femmes portant avec dextérité sur la tête, des cruches pleines d'eau. La bouse de vache était parsemée sur les sentiers, cela faisait aussi partie du décor. Je m'habituais à ce monde archaïque sans trop de difficulté.
A cette époque, la région ne possédait pas d'émetteur de télévision. Nous nous passions donc de ce moyen d'information et de distraction. Cela me permettait de passer un peu de temps chez l'une de nos voisines.
Dahbia était jeune. Elle avait deux fils pour qui elle se dévouait. Son mari mourut au maquis alors qu'elle n'avait que vingt deux ans. Son beau-frère et sa femme avec qui elle vivait, veillaient sur son honneur. Une jeune veuve pouvait être la proie de n'importe qui. Elle ressassait le passé avec son bien-aimé, les meilleurs moments qu'elle avait partagés avec lui. Dahbia n'avait aucun moyen de distraction afin de fuir la routine quotidienne. Une petite pension pour victime de la guerre l'aidait à survivre. Elle possédait à peine l'essentiel. Elle ne faisait presque jamais le ménage. Seul le passé avait de l'importance. Elle ne se sentait exister qu’à cette époque. Je crois que Dahbia avait sombré dans un état dépressif permanent. En fin d’après-midi, elle voyait sa belle sœur Baya se faire belle pour son mari quand il revenait au bercail après une rude journée au travail. Pour séduire son époux, Baya portait une longue robe bien propre. Ses dents nettoyées au brou de noix laissaient aux lèvres une teinte orangée. Ses yeux étaient soulignés au khôl. Elle se parait de quelques bijoux en argent pour donner plus d'attrait à sa toilette pourtant modeste.
Dahbia avait des nuits sans chaleur, sans amour, sans lendemains meilleurs. Elle devait survivre et c'était tout. Si vivre pleinement a un sens, pour Dahbia, ce mot voulait dire : manger, dormir, se réveiller et chaque jour recommencer la même chose. Quand elle servait le maigre repas à ses enfants, elle leur posait la marmite sur le sol. Elle ne prenait même pas la peine de mettre correctement des assiettes sur la meïda. Les deux jeunes bambins grattaient leur pitance dans le récipient. Comme la porte de leur chambre donnait directement sur la cour et qu'elle restait ouverte toute la journée, les poules venaient picorer dans la marmite les restes du repas quand il y en avait. Dahbia n'avait aucun moyen pour oublier sa solitude et meubler son temps pour sortir de l'oisiveté. Les journées devaient lui paraître interminables. Ses enfants motivaient sa vie mais, était-ce suffisant ? Tel était le sort de la majorité des veuves qui refusaient de se remarier en abandonnant leurs enfants à la belle- famille. C’était la condition pour la venue d'un prétendant. De quoi serait fait son avenir ? Connaîtrait-elle un jour la félicité ?
A la sortie de l'école, sa progéniture était livrée à elle même. Dahbia n'avait guère d'autorité sur ses jeunes mâles. Je l'admirais pour la longanimité dont elle faisait preuve. Je la revis une vingtaine d'années plus tard. Ses deux enfants ne s'étaient pas fourvoyés. L'un était devenu technicien supérieur et l'autre était régisseur dans une ferme. Avec ténacité et un grand courage, ils réussirent en unissant leurs efforts à agrandir leur demeure. Ils prirent chacun une épouse et eurent des enfants. Désormais Dahbia était bien entourée. Ses petits enfants faisaient sa fierté.
Après tant d'années écoulées, je fus surprise de constater qu'elle n'avait pas tellement changé. Ce qui m'avait le plus frappée, c'était que malgré les rides qui marquaient son visage, elle gardait encore un regard d'enfant, rempli d'innocence. Elle était restée prude et elle n'avait pas violé les mœurs en se soumettant aux règles les plus dures telles que ne pas sortir comme le prisonnier de sa geôle. Je lui avais fait une réflexion :
- Remercions Dieu, tu es heureuse à présent.
Quel fût mon étonnement quand elle me répondit en souriant avec une grande simplicité et une naïveté déconcertante.
- J'ai des couvertures et même des draps.
Je compris alors que pour elle, le bonheur était synonyme de ne plus avoir froid, de ne plus avoir faim, posséder juste l'essentiel. J'eus soudain honte, j'avais plus que l'essentiel et j'étais toujours à la recherche du bonheur.
A la même période, j'avais été témoin d'une histoire similaire de par sa tristesse. Cette autre jeune voisine s’appelait Zineb. Je comparais sa beauté à celle de Gina Lollobrigida sans vouloir exagérer. Son mari s'était exilé pour une période indéterminée vers la France. Il y travaillait et pendant les vacances d'été, il revenait auprès de sa femme et de son fils. Zineb n'avait, par an, qu'un mois de vie conjugale avec son époux qui était absent le reste du temps. Il lui envoyait de l'argent par la poste. Pendant ces onze mois de l'année dans l'attente du retour de son protecteur, Zineb devait trimer pour le compte de la belle-mère. Nettoyer la maisonnée, pétrir le pain, rouler le couscous ou laver tout le linge des membres qui composaient la belle- famille. C' était pour Zineb un devoir. En fait, la bru était synonyme de bonne à tout faire. Pendant ses longs moments de lassitude, elle rêvait au retour définitif de son mari pour que cessent les exactions de sa belle-mère.
Un jour, son bien-aimé envoya une lettre à ses parents les avertissant de son retour et exigea de ces derniers de chasser leur belle-fille. Il s'était remarié avec une occidentale. C'était tellement facile de répudier une femme. L'homme n'avait guère besoin d'une bonne raison, seul son caprice de mâle suffisait pour se défaire des liens du mariage. Le jour où le divorce fut prononcé, ce fut émouvant. En renonçant à son mari, elle devait aussi renoncer à sa progéniture. La séparation fut brutale, dure et inhumaine. Les parents de Zineb n'étaient pas disposés à nourrir la petite bouche qu’était leur petit-fils Mouloud puisque ce dernier avait un père. Pour la famille, c'était beaucoup plus une question d'honneur que de moyens.
Etant considérés comme des amis par nos voisins, le jour du départ de Mouloud, les parents de Zineb ramenèrent la mère et l’enfant chez nous. Son fils était agrippé au cou de Zineb. On aurait cru qu'à quatre ans, il devinait en lisant sur les visages, le chagrin et le désarroi de ceux qui voulaient les aider. Brutalement, on arracha de ses bras la chair de sa chair. Zineb criait en essayant de résister à l'assaut familial qui s'acharnait à lui voler son enfant. Elle se débattait mais, en vain ! Le garçon pleurait et hurlait en voulant rattraper sa mère. Il la voyait dans un drôle d'état sans en saisir le sens. Subitement ! Elle se retrouva les bras et les mains vides. Sa volonté et sa hargne à vouloir conserver ce qui lui était le plus cher, n'ont pas suffi à juguler la tradition, celle de renier ses enfants quand l'homme en répudiait la mère. Je n'ai jamais pu oublier le visage de cette mère dont la souffrance était incommensurable. Sa douleur était plus que physique, son cœur et son âme avaient été meurtris. Grâce aux potions du marabout ainsi qu’aux différentes amulettes, Zineb semblait oublier son affliction. Après trois mois d’un semblant de résignation, on lui apprit la mort de son enfant d’une pneumonie, paraît-il. Au nom de la sordide tradition, il lui fut interdit de voir sa dépouille. Elle pleurait à en devenir folle le souvenir de la chair de sa chair qu’elle ne pouvait plus blottir contre son sein tari.
Quel fût le sort de cette malheureuse parmi tant d'autres ?
Une année s'était écoulée après le drame. Un prétendant vint chez elle. Ses parents accordèrent sa main à un homme qui faisait presque le double de son âge. Son sort ne s'était guère amélioré, au contraire. Son nouveau mari était un paysan aux manières frustes. Elle devait trimer dans les champs, ramener l'eau du puits, mettre des enfants au monde, nettoyer le gîte et faire la lessive ainsi que les repas. Plus tard, quand je la revis, j'avais eu un pincement au cœur, Zineb avait changé. Elle n'avait plus cette grâce naturelle ainsi que les joues pleines qui donnaient à son visage rond, une physionomie des plus agréables à regarder. Sa peau délicate et blanche était devenue brune et ridée précocement à cause du soleil quand elle se trouvait au champ ou qu'elle participait à la cueillette des olives. On ne lisait sur son visage, ni chagrin, ni bonheur. Elle avait dépassé le stade de la souffrance. La douleur et la cruauté humaine n'avaient plus d'effet sur elle. Elle se laissait simplement survivre. Son désespoir avait pris l'aspect d'une froide résignation, même ses nouveaux enfants n'avaient pas réussi à panser ses anciennes blessures.
CHAPITRE IX
Nous menions une vie agréable puisque chez nous, il y avait une ambiance de ferme. A côté de la maison, papa avait fait construire une étable. Pour occuper son temps d'homme à la retraite, il avait acheté deux vaches suisses qu’il avait ramenées de la capitale. Deux spécimens pareils n’existaient pas dans la région. Elles étaient tachées de blanc et de noir. Elles avaient d’énormes mamelles qui leur permettaient de produire chacune jusqu’à vingt cinq litres de lait par jour. Tandis qu’une vache de la région n’en donnait que quatre litres. Papa recevait de l'argent de France de sa caisse de vieillesse. Avec le pécule qu’il percevait pour son invalidité et les allocations familiales, nous arrivions à vivre décemment.
A la campagne, nous nous dispensions de futiles dépenses. Dans le jardin, il avait planté des légumes ainsi que de l'avoine pour ses bêtes. J'éprouvais de la fierté à chaque fois que je le voyais déposer de l'herbe fraîche ou de la paille dans le beau râtelier que le menuisier avait fait. Dans les environs, les agriculteurs n'utilisaient guère ce genre de moyens pour nourrir leurs animaux. Même les poules avaient un magnifique perchoir en bois. Un ouvrier à tout faire qu'il ne rémunérait pas trop cher se chargeait de traire les bêtes. On surnommait le gentil bonhomme : Charlot à cause de sa démarche. On n’avait pas oublié les courts-métrages de Charlie Chaplin qu’on regardait en France à la télévision, les souvenirs nous poursuivaient. Papa évitait certaines besognes astreignantes à cause de sa mauvaise santé. Sa joie était de brosser énergiquement les poils de ses vaches. Pour les nettoyer, il utilisait le shampooing familial, ce qui était un luxe et une fantaisie de sa part vu le coût élevé de ce produit. Les vaches étaient propres et reluisantes. Elles faisaient sa fierté. L'une d'elles lui donnait des coups de langue lorsqu'il s'en approchait comme pour lui dire qu'elle l'aimait. De cette période, le meilleur souvenir que je garde, c'était bien la bonne odeur du fumier qui était pour moi synonyme de la joie de vivre dans la simplicité et le naturel. Lorsque mon père allait rendre visite à des amis paysans ou « fellahs » dans un autre village, il ne pouvait s’empêcher de ramasser une poignée de terre. Il la regardait et comme après une analyse, il délivrait le diagnostic ou plus précisément le verdict afin de révéler d'un ton solennel si c'était une bonne terre. Il accordait une importance primordiale à sa qualité. Il avait connu les affres de la faim pendant la deuxième guerre mondiale et il savait que comme le sein d'une mère qui rassasie son enfant, la terre nourrissait tous ceux qui prenaient soin d'elle.
La vie paisible et palpitante que menait mon père à son âge fut ternie par la mauvaise action de l'homme qui lui avait si généreusement offert la terre. Dès lors, il sut combien, il était erroné de croire que l'animal était plus féroce que l'homme. « Ce dernier grâce à son intelligence, crée des armes meurtrières même si elles ne sont que psychologiques pour détruire son semblable ». L’état nationalisa toutes les terres fertiles qui n'étaient pas travaillées. Afin de sauver son capital foncier, cet oncle avait trouvé un moyen. Il donna la terre à mon père afin de la cultiver, mais dans l'acte de propriété, il y avait une clause : « Ni vendre, ni acheter ». Ce petit subterfuge permettait à Ali d'être en réalité toujours le propriétaire du terrain. Papa ne se doutait de rien. Il savait à peine lire. Il fit donc confiance à son bienfaiteur. Quatre années environs s’étaient écoulées. A notre insu, Ali offrit une parcelle de notre jardin à son cousin sans en aviser mon père.
Ce nouveau voisin choisit de faire les fondations de sa demeure à l’emplacement des arbres. A peine un demi-mètre d’espace devait séparer nos deux maisons. Je revois encore mon père plein d’amertume, arraché des entrailles de la terre, ce qui lui était si cher. Il pleurait comme un enfant. Au crépuscule de sa vie, ce petit vieillard donnait de l’importance à celle de ses arbres qui commençaient à donner de si beaux fruits. Cette farce au goût amer ne s’effaça jamais de sa mémoire. Pourtant ! Il fut victime encore d'un incident semblable. Certaines terres nationalisées par l'état, furent rendues à leurs propriétaires. C’était une aubaine pour Ali. De manière sournoise, il vendit le restant de notre jardin à un riche entrepreneur. Mon père eut vent de la transaction commerciale à temps. Il réagit violemment. Il était prioritaire à l'achat de la terre pour y avoir travaillé et habité. Il fit valoir ses droits par le biais de la justice. Il s'endetta pour payer le terrain sur lequel fut bâtie notre maison ainsi qu'une parcelle pour conserver une partie du jardin. Il ne possédait pas assez d'argent pour payer la totalité de l'espace terrien. Le nouveau propriétaire qui avait pu acquérir la partie restante du terrain agricole, érigea une briqueterie à la bordure de notre nouveau petit jardin. La bâtisse était inesthétique. Elle masquait désormais le beau paysage dont nous avions l'habitude de jouir : les belles collines verdoyantes, les majestueuses montagnes qui se détachaient dans un ciel d’azur étaient mutilées. On n’en apercevait que les sommets. L'avoine, le potager et la beauté champêtre de l'endroit avaient été remplacés par le béton gris et sans âme. Une équipe de nuit travaillait jusqu’au petit matin, ainsi le bruit infernal des machines couvrait désormais le chant du coq et le vrombissement de l’oued de la Soummam quand il était en crue.
Petit à petit, la santé de papa déclinait au fur et à mesure que le temps passait. Il avait vendu ses deux vaches. Celle qui avait eu l’habitude de le lécher, mourut au bout de deux mois chez son nouveau propriétaire. Etait-ce dû à un mauvais traitement ? L’animal souffrait peut être de chagrin en l’absence de mon père … ! Il lui restait un bien précieux, sa dignité. Il s'était acharné pour reprendre ce qui lui revenait de droit. Il avait mené son combat jusqu’au bout, même si ses moyens financiers ne lui avaient pas permis de tout racheter. Dans un élan de colère et d'indignation, papa avait maudit la famille de cet oncle vénal. On aurait cru que Dieu avait exaucé son vœu de vengeance. Ali perdit plusieurs de ses enfants. Ils moururent successivement chacun dans des circonstances dramatiques.
Son chagrin était tellement grand qu'aucune fortune matérielle n’aurait pu adoucir sa vie. Cet oncle féodal avait usé de méthodes néo-colonialistes pour assouvir sa soif du gain. Notre terre n'était qu'une infime partie des biens fonciers qu'il possédait dans différents endroits de la région. Ali asservissait les plus faibles, les plus démunis. Il ne rémunérait jamais les femmes de ménage qui s’occupaient de l’entretien de sa demeure. La nourriture qu’il donnait aux laborieuses femmes, constituait leur seul salaire.
Le temps m'apprit que ni la religion, ni la race, ni l’ethnie d'une personne, ne faisait qu'un être humain était meilleur qu’un autre. Le grand ennemi de l'homme est l’homme avec son égoïsme et ses ambitions démesurées. Seuls les actes ont un sens.
CHAPITRE X
Toutes les émotions enfouies au fond de moi ressurgissent encore, parfois sans respecter l’ordre chronologique de ma vie vécue. Elles sont comme les plantes que l’on aurait rasées au ras du sol, les croyant mortes à tout jamais, mais en vain ! Les racines n’ayant pas été extirpées de la terre, les végétaux réapparaissent un jour. Les émotions reprennent vie comme ces plantes.
C’était par une journée de printemps que je compris combien la vie ne méritait pas d'être un gâchis. Souvent l'être humain est à la recherche du bonheur bien qu'il soit là, près de lui à le frôler comme pour avertir de sa présence. J’étais assise comme souvent, dans un coin de notre nouveau petit jardin par un après-midi de week-end, cependant, la journée me paraissait différente des autres. Dans ce lieu de méditation où des souvenirs défilaient image après image, je voulais gagner la course contre le temps. Oui ! Le temps file sans que l'on prête attention aux minutes qui s'écoulent l'une après l'autre comme lorsqu'on égrène machinalement un chapelet jusqu'au bout.
Un vent doux caressait mon visage et faisait flotter mes cheveux. L’herbe verte et abondante se laisser bercer sans se lasser. Les feuilles des hautes branches des arbres semblaient encore plus vertes et se détachaient dans un ciel d'azur. Mon regard sondait ce miroir de l'infini comme pour y découvrir la puissance créatrice. Des coquelicots et d'autres fleurs sauvages aux multiples couleurs embellissaient le modeste jardin. Toutes les fleurs se dressaient comme de jolies jeunes filles conscientes des atouts qu'offre leur beauté, celle d'envoûter inéluctablement. Le gazouillis des oiseaux éclairait un silence apaisant. Le vol gracieux de la cigogne rappelait combien le printemps était la plus belle saison de l'année, le temps de la renaissance et de la vie. Mon regard se perdit au loin pour scruter désormais les cimes des majestueuses montagnes que je devinais et que je sentais encore malgré le mur en béton qui me privait de leur vue. Je me disais que rien ne pouvait les ébranler. J’aimais à imaginer qu’elles pussent dissimuler derrière elles, un monde meilleur, une terre différente. Partout la terre est semblable lorsque les hommes qui y vivent, sont liés par l'amour du prochain, la fraternité et guidés par le noble sentiment d'équité. Seuls les actes ont un sens. Subitement, les aboiements d'un chien errant détournèrent mon attention des mille choses qui m'entouraient et de ma rêverie. « Quand bien même je serais au seuil du trépas » me dis-je « je regretterais cet animal qui pourtant m'était indifférent ». Il était l'un des signes de la vie qui battait son plein.
Goûter à un jour de printemps à Paris, était-ce possible pour les émigrés ? Les vicissitudes de leur vie donnaient à celle-ci un aspect presque monotone. Je m'interrogeais, Pourquoi hésiter sur les mots en employant le terme « presque » ? Il restait l'espoir, l'espoir pour chaque émigré d’une place dans le pays d'origine.
Pour moi, Paris n'avait qu'un seul jour de printemps, c'était le premier mai. Le monde entier célébrait la fête du travail. A Paris, la tradition était d'offrir du muguet à ceux que l'on chérissait et aux amis que l'on estimait. Chez tous les fleuristes ou à un petit coin de rue, quelqu'un nous souriait pour nous encourager à dépenser un peu d'argent contre un bouquet de belles clochettes de muguet qu'il enveloppait dans une jolie feuille de papier transparent. C'était tentant mais aussi inévitable. Ce jour-là, les gens paraissaient plus enclins à la bonne humeur, à l'indulgence envers quiconque, envers l'Arabe ou bien envers ceux de la race noire ou de la race jaune. Les Parisiens nous regardaient comme des êtres humains ; en d’autres circonstances, souvent ils oubliaient que nous étions des êtres humains. 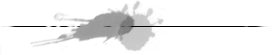
Réagir à ce texte (e-mail à l'auteur) :
|

