21/11/2002 - Chahrazed Labiod
Retrouvailles - Chapitres 11 à 13 + Epilogue
CHAPITRE XI
Les jours passèrent, les mois défilèrent l'un après l'autre. Pendant que le temps s'écoulait, je faisais de plus en plus connaissance de l'Algérie, de sa culture et de ses mœurs.
Lorsque j'observais ma mère, je sentais qu'elle m'échappait. Son allure, sa façon d'être à notre égard, avaient changé. Elle portait désormais toujours un foulard sur la tête. On ne voyait plus ses beaux cheveux noirs. A chaque fois qu'elle devait sortir avec mon père, je la comparais à un fantôme. Un voile blanc cachait sa silhouette. Elle dissimulait son visage derrière une petite voilette à l'exception de ses yeux. Maman devenait une femme soumise et résignée. Son apparence externe ne traduisait guère ses sentiments authentiques envers une société où les traditions primaient sur l’essentiel.
Parfois ! Quand elle me voyait lire un livre, elle me regardait puis me disait après un long soupir.
- Ah ! Si je pouvais lire comme toi des histoires, je n'aurais guère l'occasion de m'ennuyer.
Un jour, elle s'enquit de l'état de santé d'un vieil oncle. Je m'étonnais de l’intérêt qu'elle portait au vieux monsieur. Son explication fut au premier abord cynique même si dans le fond elle n'avait guère de mauvaises intentions.
- A son âge, cet oncle n'apporte que des tracas, s'il devait mourir, ce serait pour moi une occasion de voir du monde.
Les femmes se servaient même de la mort pour se procurer un futile plaisir. Une rencontre funéraire lui aurait donné l’occasion de se comparer à des tantes démunies ou d’autres parmi elles qui auraient des problèmes. Elle aurait voulu sans doute avoir une vision plus optimiste de ce qu’était devenue sa vie en relativisant. Maman avait pris conscience que son retour dans sa patrie n'avait pas que des avantages. J'avais l'impression que chaque femme de mon pays était dans une prison avec des barreaux invisibles. Seule chacune d’elles selon sa perception, pouvait la voir puisqu'elle était fabriquée d'interdits et de tabous. Plus de choses leur étaient permises moins la prison était petite.
Un après-midi, en revenant de l'école, je trouvai maman en pleurs. Je fus effrayée. Je pensais qu'une dispute avait éclaté entre elle et mon père. Elle me rassura très vite. Elle venait d'avoir une altercation avec l'une de nos voisines. Elle lui avait dit des paroles blessantes qui étaient un sacrilège pour ma mère.
- Dis-moi ! Est-ce que ce sont des invectives ?
- Rien de cela ma fille, des injures n’auraient pas touché ma dignité mais bien celle de la personne qui les aurait lancées. Elle a osé comparer mon fils unique au petit bourgeon parmi les solides branches de l'arbre. Elle possède six garçons, je ne fais guère le poids avec elle. Je ne représente pas grand’chose vis-à-vis de la communauté. Une mère qui a procréé plusieurs mâles vaut son pesant d'or. Grâce à ses fils, une femme peut ne pas être victime de la répudiation et elle peut aussi éviter une concubine. Les fils sont comme les solides remparts d'un château. Ils assurent la protection d'une mère sans défense.
Si j’avais été grande ! A ce moment-là, je lui aurais dit :
- Oh, Maman ! Quelle absurdité que de vouloir sublimer le mâle. Quelle signification aurait le mot « mâle » si la femme n’existait pas ? Une vie égale une vie, homme ou femme. Honores les créations de Dieu ! L’un sans l’autre, il n’y aurait pas l’espèce humaine.
Voilà que je me demandais pourquoi ma mère s’était querellée avec la voisine ? Les raisons ne manquaient pas et je supposais qu’elles étaient toutes absurdes. Jalousie entre elles ou bien des rivalités dans un domaine précis ? Qu’il soit culinaire ou familial, etc. n’importe quoi pouvait les mener à de telles dérives. Une dispute de temps à autre entre voisines, brisait la monotonie d’un quotidien routinier, sans attrait. Les femmes au foyer analphabètes ne savaient guère tuer le temps qui paraissait s’écouler lentement. Elles qui répétaient toujours les mêmes gestes mécaniques pour l’entretien de la maisonnée et la préparation des repas. C’était ainsi que le soir ma mère devrait commenter la raison de sa discorde avec la voisine. En vérité, se souciait-elle réellement de cette voisine ?
Cela était-il le prétexte qui permettait la communication entre mes parents ? Eux qui avaient lié leurs vies sans s’être connus, sans s’être aimés. Maman ne savait pas comment s’accorder un peu de plaisir pour se distraire. Elle sortait rarement de la maison sauf lors d’événement précis, accompagnée de mon père. C’était peut-être pour cela que pendant que je m’exerçais à lire à haute voix dans le dessein de m’améliorer dans cette discipline, elle m’interrompait parfois lorsque son attention s’arrêtait sur un de mes récits. Elle désirait que je lise lentement pour qu’elle puisse comprendre l’histoire. En général, sans qu’elle le sache, c’étaient les histoires de l’écrivain Algérien Mouloud Feraoun qu’elle préférait le plus. Elle me répétait alors « Quelle chance tu as d’aller à l’école ! »
C’était vrai, j’aimais l’école, mais je la redoutais à chaque fois que je devais y aller. La première et deuxième années de scolarité furent pour moi un vrai calvaire. J'avais peur à chaque fois que je devais affronter le professeur de la langue arabe. Il me battait violemment avec une baguette à cause de mon ignorance aux questions qu'il me posait pendant ses cours. Etant donné que j'avais fait les premières classes en France, je n'excellais guère dans cette langue qui était nouvelle pour moi. A la sortie de l'école, je rentrais souvent à la maison avec des traces de coups sur différentes parties de mon corps. Comme une brute, le maître prenait un malin plaisir à me rouer de coups. Lorsque ce vilain monsieur venu du Moyen-Orient me demandait « pourquoi étais-je nulle ? », je lui rétorquais qu’après le français que je connaissais pour des raisons évidentes, je ne pouvais m'exprimer que dans ma langue maternelle : le Kabyle.
- Mais, me disait-il pour me ridiculiser devant mes petites camarades, tu es Algérienne !
Oubliait-il que parmi tous ces Algériens, depuis très longtemps, il y avait des personnes qui ne s'exprimaient que dans leur langue maternelle, que ce soit : le Kabyle, le Chaoui, le Mozabite ou le Targui, selon la région où ils habitaient. Pourquoi donc, j'ignorais l'Arabe ? Seuls mes parents pouvaient répondre à une telle question. Un jour je compris alors, qu’un Arabe d’Algérie qui ne se dirait pas aussi Kabyle ou plus globalement Berbère serait plus un Arabe qu’un Algérien.
Si je devais évoquer un des aspects de la culture algérienne à travers sa musique, comment décrire les cris mélodieux des femmes des Aurès qui chantent la vie, le courage de leurs hommes et l’abnégation des femmes qui veulent construire une vraie nation ? L’envoûtante et charmeuse musique andalouse qui fait la fierté de l’Algérie en particulier Constantine, Tlemcen et Annaba. Le Raï ! Cette tonitruante musique oranaise qui fait danser la jeunesse algérienne assoiffée de loisirs. L’Algérois dont la musique Châabi ou populaire dans un arabe bien de chez nous, a fait presque naître un hymne international puisque dans plusieurs langues, avait été fredonnée la chanson « Ya rayah » de feu Dahmane El Harachi. Par cette mélodie, le célèbre chanteur Rachid Taha a su rendre nostalgiques tous les immigrés de France. Je n’oublie pas les airs joyeux et colorés de la Kabylie. C’est tout cela notre Algérie !
Ainsi, j’appréhendais la pluie de coups de bâton qui devait s’abattre sur moi pendant les journées de classe. La peur qui me tiraillait intérieurement me faisait détester le chemin de l’école à un point que je devenais agoraphobe. Mon père m’emmena chez un médecin qui diagnostiqua une maladie du foie. Plus tard, je sus que ma crainte de sortir qui s’accompagnait de vertiges, était due à mon état émotionnel fort perturbé par tant de violence. Avant chaque cours d’arabe qui me remplissait d’effroi par rapport à ce que je subissais perpétuellement, j’exorcisais ma terreur en faisant appel à mon imaginaire d’enfant. Je me voyais surgissant d’une manière impromptue en plein cours, déguisée en Zorro comme le personnage d’un film que j’avais souvent vu en France à la télévision. Enfin, je me faisais justice en châtiant le maître comme le justicier envers les méchants. De cette manière j’arrivais à calmer ma peur et ma haine quand celles-ci atteignaient un degré insupportable. Serait-ce ainsi que naissent les germes de la violence dans le cœur des enfants ? Probablement, un cas parmi tant d’autres…
CHAPITRE XII
Au fur et à mesure que les mois passaient, j'avais l'impression d'être sur une autre planète. Entre les adultes et les enfants, il n'y avait pas suffisamment de communication. On n'expliquait guère à ces derniers le pourquoi ou le comment de certaines choses de la vie. Ils devaient obéir comme des petits animaux domestiques et satisfaire les désirs des grands. C'était l'un des aspects de la société patriarcale.
A douze ans, je n'avais toujours pas compris, pourquoi mon monde imaginaire qui, jadis, était peuplé de fées et de sorcières, n'existait plus ? Dans mon imagination de petite fille marquée par une culture occidentale, je devais tout gommer de ma mémoire comme si je n'avais jamais connu d'autres horizons, comme une bande magnétique que l'on aurait effacée. Personne ne m'avait expliqué, pourquoi dans mon pays tout était différent ? J'avais donc remplacé les deux personnages chimériques par le mauvais esprit et le mauvais œil. Ce qui faisait naître en moi une peur sourde, c'était ce qui entravait ma logique d'enfant. En France, le mal était concrétisé par une sorcière, une femme aux ongles crochus qui, selon la légende, se déplaçait sur un balai. Tant que l'on ne se trouvait pas en face d'un être aussi laid et aussi invraisemblable, il n'y avait pas lieu de s'inquiéter. Le mauvais esprit était pour moi plus étrange et plus effrayant. Les gens s'accordaient à dire que les Djins ou Démons n’avaient pas de forme précise puisqu’ils pouvaient se réincarner en n'importe quel être tel qu'une grenouille ou une jolie femme etc. et faire subir à leur victime un vilain sort. Mythe, légende ? Cela donnait naissance à la peur, à la méfiance excessive. Involontairement, on se trouvait pris dans le piège de la superstition.
Tiraillée entre deux cultures différentes, je me sentais confrontée à un sérieux problème d'identité. Je ne pouvais m’identifier aux Françaises, ayant des parents algériens et inversement, je ne m'identifiais pas aux Algériennes puisque ma façon de percevoir les choses était différente. Pour éviter d'être marginalisée, j'acceptais bon gré, mal gré, cette nouvelle vision de la vie mais sans être dans le fond en accord avec moi-même. « La pire des choses pour un individu, c'est de tricher avec lui-même… » Ce qui me tourmentait, c'était que je n'arrivais pas à définir avec exactitude ce que j'étais réellement.
J'avais grandi, ma silhouette s'était métamorphosée. S'il est agréable pour une jeune fille de découvrir que ses nouvelles formes lui donnent grâce et féminité souvent son être de chair n'est guère en accord avec son esprit. Les interdits ou tabous voulaient qu'une fille fasse abnégation de son corps, de ses désirs naturels et biologiques tels que simplement aimer. Pour trouver l'équilibre, l'unique solution pour la gent féminine, était le mariage. Combien de jeunes filles se jetèrent dans les bras d'un homme quelconque afin d'éviter certaines frustrations. Une fois la libido satisfaite, ce qui n'était pas souvent le cas, vu que les partenaires se connaissaient à peine ou pas du tout, ils se heurtaient à la dure réalité de la vie. La réussite d'une vie commune ne peut se limiter à satisfaire les pulsions primitives de chacun. Sans affinité des caractères, sans compréhension mutuelle, le mariage est voué inéluctablement à l'échec. Des maris autoritaires souvent despotiques étouffaient les désirs et les espérances de ces épouses. Une femme ne devait avoir ni rêve, ni aspiration.
Avec l'âge, je sentais que je détestais être une femme, point pour être un homme, mais je voulais être un oiseau, sans attache. « L'oiseau parait libre, pourtant sa liberté est une illusion puisque purement mécanique. Le temps m'apprit que la véritable liberté était la communication entre les hommes. Le moyen étant la parole, les mots devraient être admis dans toutes les langues. La tolérance est aussi un critère de liberté à une condition que cette dernière rejette un monde pervers qui porterait préjudice à la pérennité de la race humaine. Bien souvent pour légitimer des déviations de comportements humains, on parle de tolérance. La meilleure solution pour un individu afin de trouver une réponse à ses différentes questions est la communication, parler, mais aussi être entendu, être écouté afin que cela ne devienne pas un simple monologue. »
Ma vision des femmes de mon pays était qu'elles évoluaient misérablement puisque les hommes faisaient fi de leurs choix. L'idéal pour les femmes était que la gent masculine permette à chacune d'entre elles de s'épanouir en mettant en pratique ses aptitudes, sa créativité si tel était son vœu. Souvent de par la tradition, son rôle se limitait aux tâches serviles. L'absurdité de sa besogne la faisait paraître stupide, incapable et inoffensive. Les femmes se sentaient atteintes dans leur dignité. Leur courage, leur intelligence, étaient comme un affront envers les hommes comme si leurs qualités allaient mettre en exergue la faiblesse de certains mâles trop longtemps maternés ou dominés par un père autoritaire.
Je grandissais et je réalisais combien les moyens de survie des femmes étaient précaires. La plupart étaient analphabètes ce qui renforçait leur ignorance à se défendre quand elles se heurtaient à des difficultés pour protéger leurs acquis comme éviter d'être rejetées par un mari où l'arbitraire était chose normale. Selon la tradition, les filles devaient aussi renoncer à l’héritage familial. Sans ce sacrifice, elles risquaient, en devenant des femmes, de ne pas être représentées par les hommes de la famille si la conjoncture les y obligeaient. Cette forme de chantage implicite, affaiblissait davantage la femme. Quelle arme pour se défendre dans de telles circonstances ? Une possibilité ! Les femmes développaient une stratégie : la fourberie. Cette arme me faisait peur. Il fallait tricher, mentir pour survivre et conserver sa place au sein de la communauté où elles existaient. Il était rare qu’une femme ait une forte personnalité ou une personnalité tout court. Toutes paraissaient se ressembler dans leur façon d’être. La peur dominait et dirigeait leur existence. Seules, quelques audacieuses bravaient certains obstacles ou interdits. C’était des rebelles. La plupart étaient soumises, obéissantes. En réalité chacune d’elles était comme un volcan dont l’éruption était latente.
Celle-ci se manifestait parfois plus tard sous des formes différentes. Il y avait les dépressives toujours mal dans leur peau, les hystériques avec leurs déroutants symptômes où celles atteintes de maladies psychosomatiques dues aux refoulements de leurs révoltes. Les rescapées étaient les femmes dont le tempérament était exceptionnellement coriace.
Toutes ces choses qui touchaient les femmes, me poussaient à être en quête de ma première peur, celle qui avait germé dans mon inconscient. Ce trou noir faisait rejaillir parfois des fragments d’émotion qui me tourmentaient alors que je les croyais ensevelis à tout jamais dans les ténèbres de mon « moi ». Avais-je connu la vraie peur à l’école avec toutes les difficultés que j’y avais rencontrées ? Ou bien, était ce le premier mariage auquel j’avais dû assister pour la première fois ? Ce but final que voudrait atteindre chaque fille pour devenir une femme.
Je pensais parfois à la petite Rania. Elle habitait à la montagne loin de tout confort même le plus rudimentaire. Elle cherchait de l’eau au puits pour les besoins du logis de la misère. Elle s’y rendait pieds nus. Il y avait aussi les fagots de bois qu’elle rapportait de la forêt sur son dos frêle. C’était le seul moyen de combustion que la famille possédait. Mais, un jour, le « prince charmant » vint la demander en mariage. La coutume voulait qu’elle ne vît pas son fiancé. Il était instituteur d’un bon milieu social. Tandis qu’elle n’avait que douze ans, le prétendant atteignait les vingt trois ans. Qu’importe ! Un si bon parti ne se refusait pas. La cérémonie pour célébrer leur union fut une fête toute en couleur. Les femmes étaient vêtues de longues robes gaiement colorées et chatoyantes. Les youyous fusaient de partout. Les gens se gavaient de couscous arrosé de sauce avec des légumes divers ainsi que de gros morceaux de viande. La future belle-mère et ses filles distribuaient des gâteaux aux invités. On buvait du petit lait en abondance. A cette époque, la limonade n’était guère servie en de telles circonstances. Les femmes dansaient au rythme du tambour, d’autres chantaient des chansons joyeuses. A la campagne, les gens n’utilisaient pas de moyens modernes pour faire de la musique tel un tourne disques. Pour cela, il fallait avoir chez soi de l’électricité. A l’extérieur de la maison, les hommes installés sous une tonnelle de vigne, discutaient autour d’un café. Deux ou trois personnes armées chacune d’une carabine, tiraient en l’air, des salves de coups de fusil en signe de réjouissance. Les armes étaient symbole de virilité et de puissance. Les enfants admiratifs par tant de pouvoir, se contentaient de ramasser les cartouches vides que les guerriers pacifiques avaient jeté sur le sol de terre battue.
Voilà qu’en fin de soirée, le moment de vérité arriva. Le marié dans sa tenue princière pénétra dans la chambre nuptiale rejoindre son épouse. Les femmes s’agglutinèrent derrière la porte. Dans un silence solennel, elles épiaient le moindre son qui pouvait venir de la pièce. Je sus que le jeune mâle avait offert des friandises et quelques présents à la jeune adolescente, quand alors, impatient, parfois sans douceur, il lui arracha ses vêtements et prit ce qu’elle avait de plus intime et de plus secret. L’innocente dans une douleur sourde, donna sans résistance sa pureté de vierge pour devenir une femme. Après s’être repu de chair, fièrement, le mari arbora devant les membres masculins de la famille, tel un vainqueur, la chemise de nuit de sa femme qui était tachée de sang. Les femmes poussèrent des youyous pour signaler aux voisins des environs que la fête s’était achevée dans l’honneur. Quelques années plus tard, Rania aura terminé sa croissance au sein de sa nouvelle famille qui l’aura vue se métamorphoser. Elle atteignit un mètre soixante quinze alors que son mari n’en faisait qu’un mètre quarante. A l’âge de la maturité, elle comprit son sacrifice à vivre dans le confort. L’injustice dont elle avait été victime en épousant un homme qu’elle n’avait pas choisi. Ainsi ! La tradition incitait la fille à renoncer à elle-même. Elle n’avait pas le droit d’exister en tant qu’individu à part entière avec ses rêves, ses désirs et ses aspirations.
CHAPITRE XIII
La première fois où j'avais réalisé avoir quitté le merveilleux monde de l'enfance pour être perçue par les autres comme une femme fut pour moi un moment douloureux. Je fus glacée d'effroi et je me sentis enveloppée par une insécurité que je n'arrivais pas à définir. J'avais dix sept ans et j'étais encore bercée par le magnifique rêve d'un avenir toujours meilleur. Mais un incident d'apparence banal me vola mon rêve pour me faire pénétrer dans le monde de la dure réalité, dans le monde ingrat des adultes.
C'était un dimanche après-midi, nous prenions tranquillement le goûter dans la courette. Du café, du lait, de la galette et quelques gâteaux de la région garnissaient la petite medïa. Alors que nous discutions paisiblement en sirotant chacun notre breuvage, nous entendîmes soudain un drôle de vacarme qui provenait de la rue parallèle à notre maison. C'étaient des sons de Derbouka. Papa sortit dehors pour s’enquérir des raisons du raffut. Un moment s'écoula, il revint accompagné par une horde de femmes. Papa riait en s'exclamant ! :
- Voyez ma fille, elle va encore à l'école, la plus grande se trouve en France pour des études. Je ne peux donc vous donner celle-ci qui est plus jeune. La tradition ne le permet pas !
Il parlait de moi comme d'un veau qu'il aurait engraissé mais qui n'aurait pas été prêt à la vente. Les femmes me dévisageaient de la tête aux pieds. Elles me regardaient d'un air inquisiteur. Elles paraissaient satisfaites. Je crois qu'elles considéraient que j'avais les paramètres physiques pour faire une bru idéale. Le poids, la taille, la couleur de la peau, le visage et les jambes lorsqu'elles n'étaient pas cachées sous une longue robe étaient passés en revue.
Je tremblais comme une feuille devant ces femmes que je trouvais hostiles. Bien que flattée, une seule question trottait dans ma tête. « Est-ce que mon père allait me sacrifier à ces gens rustres qui ne faisaient guère partie de mon monde imaginaire mais réel de l'autre côté de la Méditerranée ? Un monde ou les mots « droit et liberté » ont un sens. Une terre ou un être humain est responsable de son destin avec la volonté de Dieu ». Ces entremetteuses étaient tenaces. Elles donnaient des arguments tels mon âge ou les qualités du futur époux pour convaincre mon père à céder à leurs désirs. Elles n'étaient pas insensibles à mon innocence et à ma pudeur qui étaient une conséquence d'une inexpérience de la vie.
J'avais été soumise à une éducation très rigoureuse où la moralité primait sur tout le reste. En essuyant le refus catégorique de mon père, nos invitées n'acceptèrent pas le café que maman s'était empressée de leur servir. Avant de nous quitter, les dames nous saluèrent avec un air pincé. Elles étaient déçues de n'avoir pas réglé leur transaction commerciale. En échange de ma main, les prétendantes avaient proposé une belle somme d'argent en plus d'une dot à mes parents. Je fus contente de les voir partir. Ma curiosité me poussa vers la porte qui donnait sur l'extérieur.
Discrètement, par l’entrebaîllement, je regardais le jeune futur marié. Je ressentis de la répugnance à son égard. De par son attitude, il était comme l'animal affamé qui attendait la prise de sa proie. Comment pouvais-je lier ma vie à un homme que je ne connaissais guère, un être pour qui je n’avais aucun sentiment ? J'avais compris que seules des études réussies pouvaient me faire gagner un sursis à ce genre de mésaventure. Depuis ce jour, j'étais devenue pessimiste. Je me refermais sur moi-même. A mes moments d'oisiveté, je me recroquevillais comme le fœtus dans le ventre de sa mère. J'avais peur de l'avenir…Je repensais à mon premier cocon familial, le bercail de ma petite enfance…
EPILOGUE
Au tréfonds de lui, l'homme est agité par des tourments, tout comme les remous et les mystères des profondeurs d'un océan qui épouse les magnifiques couleurs apaisantes et changeantes du ciel. Si le corps abrite la force de vie pour lui donner la forme d'un être fragile et mortel, il est la geôle de cette force de vie qui s'échappera un jour pour trouver la liberté sous un aspect différent.
Si naître c'est avoir la possibilité de connaître la terre aux contours définis, mourir c'est renaître pour retourner à la source et découvrir la lumière d'un univers infini et éternel.
A SUIVRE…. 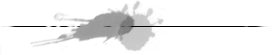
Réagir à ce texte (e-mail à l'auteur) :
|

