30/11/2003 - Senhal
La terre et le vent
Douze heures trente. Pour les êtres du commun, prosaïques, pour l’espèce perfectible. L’heure pour eux de prendre rapidement leur repas.
Voyons... Au vu de la température de l’écorce terrestre, je dirais que nous sommes fin avril : les lycéens doivent être en train de prendre leur déjeuner sur le tapis d’herbe du Paquier, à côté du manège. Sandwiches, Panini, salades à composer soi-même, de chez Barnabé.
Oui, je ne me suis pas trompé. Le manège, les lycéens, fin avril ; les pétales rose clair sur le sol commencent à se décomposer.
Et ça bavarde, et cui cui cui, bla bla bla.
Ils piétinent la pelouse verte fraîchement posée, qui amortit leurs pas désordonnés.
Cette scène me traverse comme un soubresaut de conscience, impromptue. Juste une image, un sentiment furtif et glissant comme un rêve avant l’éveil !
Il y a un couple. Non, c’est un garçon et une fille, ils sont inscrits au même lycée. Ils sont très beaux tous les deux, d’une beauté rare, atypique. Le garçon a une odeur naturelle poudreuse comme une terre arable en été, couleur ardoise, ambrée, rouge, somptueuse, brute. Cette odeur volatile s’alourdit en croisant celle, huileuse, amère, des pétales roses, puis le gazon empuantit, saturé. Plus profond vient le terreau humide, frais, avec son air capturé. Heureusement, je peux choisir les odeurs qui m’intéressent. Quel parfum ! À son image, l’être qui le porte est souple et léger, ses pieds marquent à peine l’herbe moite. J’aimerais le voir, il m’attire. Le toucher.
Et la fille.
I
Le temps trace sa courbe dans un repère logarithmique, ou bien c’est ma conscience des choses. Depuis combien de temps suis-je là ?
Ils sont partis, depuis des années déjà, je le vois bien. Ou plutôt je le sens ; avant, il y avait un manège en bois qui grinçait en tournant.
Partis.
Julien. Oui, c’est ça, je l’ai distraitement perçu lorsque le manège était encore là. Il y a longtemps que ça ne m’était pas arrivé. Je veux dire, m’attarder sur un individu en particulier, jusqu’à me souvenir de son prénom. Quelle délicieuse odeur !
Quelque chose doit aller de travers. J’aurais dû être plus attentif ces derniers siècles, surtout après l’avènement de l’ère chrétienne. Mais j’étais dans un sommeil si léthargique. Le poids de tant de temps est difficile à digérer, même pour moi, ça a dû me rendre un peu somnolent.
Je suis peut-être en train de me réveiller. Oui, j’accède à un autre type de pensée, non pas plus cohérent, mais plus axé sur la logique et la mémoire que sur les sensations. Disons que les sensations ne prennent plus le dessus, elles ne sont que le point de départ de ma réflexion.
Ainsi, me revoilà.
Le voit-il ? Le sent-il, comme il prétend tout savoir ? Comme il prétend avoir tout engendré ? Encore lui, toujours ! Mais il n’en sera pas éternellement ainsi. Et je ne crois pas qu’il en a intemporellement été ainsi. Mais comment savoir ? Il a l’avantage de la longévité, moi, je n’existais pas encore. Je pense qu’il cache des choses, je ne suis pas le seul, j’ai eu des prédécesseurs. Surtout un, il a laissé son empreinte dans l’épopée humaine, perforant, agrandissant mais aggravant la conscience. Je n’en suis pas spécialement content, ou même scandalisé. Mais c’est arrivé, c’est un fait. Enfin peut-être. Mais laissons cela pour l’heure, que vais-je faire ? Car il faut changer tout ça.
Bon, d’abord mon corps, qu’est-il devenu ? Je le sens vaguement, intensément. Il est de certaines sensations dont le vague n’exclut pas l’intensité. Il n’est pas personnel, des ondes sismiques le parcourent, le bouillonnement du magma, le départ d’une fusée. Chatouillé par le crissement des minuscules insectes, des vers visqueux, des petits rongeurs aveugles, le ronronnement des voitures, le gargouillement ruisselant des tuyaux. Mon corps est vivant, vibrant, caisse de résonance de toute vie, de tout mouvement, mais en même temps, quelle inertie ! Un luth de pierre.
Je sais, je sens, je l’ai déduis : je suis fossilisé. Ça devait se produire, depuis tout ce temps. Je ne vois vraiment pas comment faire. Impossible de gouverner la moindre parcelle de mon corps. C’est bête, tellement bête ! Je suis si près de la surface.
Ennuyeux, vraiment ennuyeux. Très ennuyeux ! Foutre dieu de merde ! Rââh ! J’en ai assez, je veux sortir ! Oh, quelle merde, comment ai-je pu en arriver à ce stade ? Et surtout, à ce stade marmoréen, qu’est-ce qui a pu m’ébranler ? Rien ne fonctionne, ni pied, ni bras, je ne respire même pas. Appelez un médecin !
De toute façon, à quoi bon respirer ? Il n’y a presque pas d’air ici.
J’aimerais savoir où est Julien, qu’est-il devenu ? De quand date ma vision ? Dix ans ? Je ne parviens pas à me rendre compte. Peut-être est-il mort et enterré, cloîtré dans l’un de ces cercueils stériles et imperméables aux insectes ? J’espère que non. J’ai vraiment envie de le toucher, c’est important.
Et la fille ? Il y avait donc une fille. Y avait-il une fille ? J’ai l’impression que oui. Mais je n’ai pas la prétention, moi, de ne jamais commettre d’erreur.
Noir.
Ah, de la couleur ! Abracadabra. Je ne dis pas que ce teint opaque fait partie de l’éventail spectral, il paraît que ce n’est même pas une carnation possible. C’est exact, je le sais depuis toujours (toujours représente depuis que j’existe), j’ai une connaissance à peu près universelle des choses de la nature, de façon particulière et générale. Mais je dois dire que ça ne m’a jamais vraiment intéressé. Ainsi, il fait noir. C’est déjà un progrès, avant, je voyais moins que noir, je ne voyais rien, c’est indescriptible.
I, divisibilité. Maintenant, de petits pics lumineux sont visibles, étincelles cramoisies. De la lumière doit filtrer à travers mes paupières filetées. En étrécissant mes pupilles, j’arrive à distinguer plus nettement le réseau de petites veines noircies pas la pénurie de sang. C’est encourageant, je recouvre mes capacités visuelles. Mais d’où provient cette clarté ? Devant mes orbites dansent désormais de minuscules formes diaprées.
Les tuyaux qui transportent habituellement l’eau sont vides au-dessus de moi, quelque chose de mécanique frappe en cadence. Ça me fait penser à la danse macabre de Saint Saëns. Il doit y avoir des travaux d’entretien.
Je me rends compte qu’un changement s’est opéré. Les vibrations me traversent différemment, la terre rocheuse et l’eau aquifère ne servent plus de filtre. Tout me paraît brutal. Au vu de la fréquence des ondes sonores, je devrais être capable de percevoir les sons, mais rien. Preuve que mon système auditif est encore en veille. Je n’aime pas ça, que va-t-il se passer ? Il faut que la situation évolue, c’est insupportable, je suis maintenant dans un état de lucidité parfaite, j’ai une conscience aiguë, mais mon corps est une prison de marbre.
D’après mes calculs, je dois être à peine à quelques centimètres de la surface. Mais si je n’ai pas été découvert les dernières fois, pourquoi le serais-je cette fois-ci ?
Nous sommes en automne, je dirais octobre. Mais de quelle année ? De quel siècle ? De quel pays ? Car bien des cités ont dû naître, puis mourir, c’est le destin de toute chose sur Terre, d’une certaine manière. Il serait plus juste de dire que tout croît, puis de résorbe. Voilà un paramètre à prendre en compte, bien des souverains l’ont oublié dans le passé. A quoi rime de rêver aux jours dorés lorsque le déclin est amorcé ? Il ne faut pas persister, à quoi bon vivre dans une carcasse ? On vous fait croire que les murs peuvent être sauvés, mais le cœur est mort, les murs sont lépreux. L’humanité est un peuple nomade. Les catastrophes naturelles finissent par se multiplier, les maisons s’effondrent et on accuse le mauvais entretien. C’est du déjà vu. Comme tout organisme, l’urbanisme est soumis au cycle de la vie. Car la plus forte, c’est elle, la nature. Elle finit toujours par considérer la cité comme une épine gênante. Et si un jour la ville se croit de fait la plus forte, c’est l’implosion qui la ronge.
Mon sommeil ne fut pas amorphe. J’ai suivi les changements subtils, les grands mouvements de l’humanité, ma conscience latente se mêlant à celle des autres. Les peuples se sont accrochés aux pierres grises en grappes agglutinées, de plus en plus turgescentes. Mais le gravier vampirisé s’est tari, la jachère ne suffira plus dans la perspective de l’émiettement final, irrémédiable.
Je ne sais pas ce qui s’est passé ces dernières décennies, mais je me sens oppressé par le vide. Je croyais ne pas respirer, mais c’est faux, je m’en rends compte maintenant. J’inhale l’inconsistance de ce siècle.
Il faut changer tout ça.
II
Loin dans le temps. Loin dans le monde, au seuil de l’humanité. Lorsque l’harmonie était terre et vent. À cet instant de l’Histoire, les couleurs sont neuves et humides comme les boutons éclos. Les fûts verticaux sont des hommes placides sortant du sol vers le ciel où les végétaux jettent leurs ponts de dentelle verte. Et au milieu coule une rivière bleue que les arbres laissent passer. Près de l’eau un rocher.
Et le vent est libre, il joue dans les feuilles, il joue dans les nuages, et le rocher se sent seul. Mais le vent va caresser l’herbe pour la coucher, alors le rocher lui pardonne, car l’herbe est si près du sol. Histoire de s’amuser, la brise prend des grains de sable et s’envole, et s’arrête de l’autre côté de l’hémisphère, au milieu de la mer. Là, elle lâche un à un les grains de poussière qui, morts de rire, font de petits ronds dans l’eau.
Mais dans l’eau, il n’y a pas de vent, juste des courants. De quoi vous polir et vous réduire, jusqu’à n’être plus rien. Tendre peine, puisqu'accompagnée du souvenir du voyage qui vous a mena ici. Qui me mena là dans l’infinie dissolution de mon être en une éternelle extension. Ma vengeance sera douce mon amour.
Sais-tu que je t’aime ? Je t’aime de toute la terre, de tout le sable, de la glaise et des opales dans les rivières, mais le sais-tu seulement ? Nos enfants seront les dunes mouvantes, mais tu ne m’entends pas. Le vent et la terre ne parlent pas.
III
Mais dans un premier temps, il faut que je sorte de là. De moi-même, je ne peux rien. Je suis totalement inerte. La couche supérieure de mon épiderme est minérale. Vu ma petite taille, dans les un mètre soixante, d’après le système métrique adopté le 2 mai 1875, je dois ressembler à une statue antique, une quelconque divinité païenne. Si jamais on me trouvait, je serais certain d’être déterré, je suis une curiosité, peut-être une découverte sans précédant dans le domaine de l’archéologie. Encore faudrait-il que l’on me trouve.
Il fait nuit maintenant. Le vent souffle méticuleusement entre les brins d‘herbe, mais soudain tout semble étrangement tiède et froid en même temps. Rouge.
Une ombre investigatrice, plus sombre que la nuit, plus froide que l’ennui, chasse la douce brise et pénètre dans la terre, pénètre dans mes membres et m’oppresse. Des pas l’accompagnent lentement mais assurément, je les perçois depuis tout à l’heure, mais je m’en rends compte seulement maintenant. Toute sombre, ma pensée s’encombre. Je ne ressens pas de peur. Mais la compréhension du phénomène semble appeler des éléments enfouis dans ma mémoire ensablée. Des pas au cœur de l’ombre, des pas qui marquent à peine l’herbe noire...
Julien. Il se baisse lentement, plie ses articulations jusqu’à ce que ses genoux frôlent la moiteur (). Il pose sa main sur le sol et je veux lui répondre de tout mon être. Il m’appelle et je veux venir. Mais je ne peux pas.
« Elle ne veut plus de toi ». Sa voix est si belle. Que dit-elle ? Qui ne veut plus de moi ? Mais déjà Julien s’en va. Non. Reviens. Je ne comprends pas.
Les genoux ont fait deux petits creux dans l’herbe.
L’air espace à nouveau ses particules. La douceur du soir revient. Je ne suis pas certain, je ne me souviens de rien. Il faut que je change tout ça, il faut que je le retrouve, il faut que je me souvienne.
Ce soir-là tout s’immobilisa, pas même un souffle dans la nuit, mais les chiens hurlèrent dans les jardins, caniches et teckels, leurs maîtres les réprimandèrent en pyjama. Mais ces pantins grotesques changèrent vite de centre d’intérêt car alors la terre trembla. Elle ne voulait plus de moi.
Je suis une masse blanche que les étoiles inondent comme un vernis laque, un morceau d’albâtre serti dans la sombre terre révulsée. J’attends le jour pour que le soleil indiscret me dévoile aux yeux de l’humanité.
Un petit oiseau passe et mon cœur bondit. Il doit battre très vite des ailes car l’air léger a du mal à le porter.
Je me sens un peu coupable. Mais de quoi ? 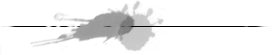
Réagir à ce texte (e-mail à l'auteur) :
|

