18/01/2004 - Eric Van Cutsem
La concierge
Je détestais cette femme… Sa vulgarité, son habillement, ses manières, tout en elle choquait mes sens, piquant mes nerfs à vif.
Je haïssais cette femme, ce représentant larvé de cette race larvaire.
Pour tout vous dire, cette femme est la concierge de mon immeuble, mais pas n’importe quelle concierge… non, non…, une vraie de vrai, une pure, la quintessence de la conciergerie, le voyeurisme fait femme, la condescendance personnalisée, avec un sourire posé sur son visage comme une poubelle sur un trottoir… Elle représentait pour moi une sorte de sommet évolutif en matière de concierge, comme si une sélection naturelle avait opéré depuis des millénaires pour aboutir à ça : ce petit bout de femme aux cheveux gris en chignon, aux lunettes rondes posées sur un repli de chair rappelant vaguement la forme d’un nez, au tablier à fleurs terni par des lavages maintes fois répétés, aux mains calleuses et déformées par l’usage permanent du balai… Son image s’imposait de plus en plus à mon esprit, devenant ainsi une de ces caricatures si souvent dépeintes au cinéma ou dans les romans bon marché !
Il est impossible que vous n’ayez jamais ressenti de la haine pour ce regard posé sur vos épaules alors que vous gravissiez les marches d’un quelconque immeuble à la rencontre d’une de vos amourettes discrètes. Ce regard pesant, lourd de sous-entendus vous suit alors que résonne encore à vos oreilles le “troisième, la porte à gauche en haut de l’escalier”, hurlé plus que parlé ! Si vous n’avez jamais eu ce sentiment, c’est que vous n’avez probablement jamais rencontré de concierge ou, peut-être, êtes-vous concierge ?
Une des raisons fondamentales de ma haine repose sur ma répulsion envers le genre humain. Je dois bien avouer que je n’ai jamais été quelqu’un de facile, ma misanthropie m’entraînant souvent dans des discours rageurs qui me valaient beaucoup d’inimitiés et pas mal d’incompréhension. Depuis mon plus jeune âge, l’humanité m’était apparue comme une sorte de verrue poussant à la face du monde, verrue que si l’on m’avait laissé faire, j’aurais brûlée depuis bien longtemps. Ce que je détestais ? Oh, par-dessus tout la fatuité de l’homme, sa prétention à la place d’animal supérieur, si supérieur qu’il renonçait même à son statut d’animal pour mieux endosser sa peau d’être humain… Tout ce que l’homme a de supérieur est en fait la possibilité de se considérer comme supérieur !
Et c’est ces traits de caractère que je retrouvais, en tout ou en partie, dans le microcosme de mon garde-chiourme. Comme si le panonceau délavé reprenant les mots magiques “La concierge est dans l’escalier” s’estompait dans un souffle pour être remplacé par une pancarte aux lettres de sang : “La pourriture est sur le monde”…
Non, je n’étais pas fou et je ne le suis toujours pas… Cette femme espionnait chacun de mes faits et gestes, me poursuivant du regard, portant mon courrier jusque sous ma porte afin de mieux y coller son oreille jaunie et racornie. Elle saisissait ma vie à pleines mains, s’y insinuant sournoisement, se glissant entre mes actes pour mieux les observer et mieux les contrôler. Mon célibat la réjouissait, faisant de moi sa créature… L’homme d’une seule femme, elle !
Souvent, je la sentais présente plus que je ne la voyais. Passant dans le grand hall d’entrée en travertin, je la devinais derrière les rideaux de sa loge, m’observant au-dessus de ses lunettes et trahissant sa présence par son écriteau retourné. La concierge n’était pas dans l’escalier. Oh, non, elle était là, aux aguets, suivant chacun de mes pas, soupesant chacun de mes gestes, devinant ce que j’avais bien pu faire dehors, hors de son emprise, hors de ses griffes. Parfois, sa porte s’entrouvrait dans mon dos et elle me jetait un “Beau temps pour la saison, n’est-ce pas ? J’ai porté votre courrier devant votre porte, Monsieur Paul. ” Raah, ce monsieur Paul… comme il me faisait mal ! Comme il me rappelait notre connivence, presque notre intimité ! Quel être stupide et faible avais-je été de lui glisser un jour entre deux volées d’escalier qu’elle pouvait m’appeler par mon prénom, Paul… J’aurais voulu changer d’état civil. Maintes fois d’ailleurs, j’ai songé le faire. Mais qu’aurais-je pu invoquer auprès des autorités ? Ma concierge connaît mon nom, je voudrais en changer. Il m’aurait pris pour un fou. Or je ne suis pas fou… vous m’entendez, pas fou du tout !
En fait, maintenant que j’y réfléchis, avec un peu de recul, elle me terrorisait. Je crois que c’est le terme exact. Je la haïssais, mais en même temps elle m’effrayait, me laissant macérer dans un état de terreur indicible. Elle était concierge de l’immeuble et aussi concierge de ma peur… Elle l’entretenait avec amour et tendresse, ranimant sa flamme par de petites touches : une présence dans un recoin de l’escalier, le courrier devant ma porte, son “La concierge est dans l’escalier”, l’odeur du couloir fraîchement nettoyé ou encore, un paillasson dépoussiéré puis remis à sa place… Toutes ces petites choses qui faisaient d’elle le maître de ma peur et moi son esclave. Chaque matin et chaque soir –j’avais un emploi à heures fixes au Ministère des Travaux Publics–, elle était là, m’attendant comme par miracle en quelque lieu secret de l’immeuble. Dans sa loge si je passais par le hall, dans les caves si je rentrais par le garage, à mon étage si je prenais l’ascenseur ou dans l’escalier si j’avais choisi de me mettre en jambes, elle était partout et nulle part. J’aurais été croyant en une quelconque forme de parapsychologie (ce n’était pas le cas, rassurez-vous, je vous ai déjà dit que je n’étais pas fou), j’aurais immédiatement pensé qu’elle était médium, voyante ou ex-diseuse de bonne aventure dans une foire ringarde. Mais je crois que c’était beaucoup plus simple que ça. Elle humait ma peur de la voir. Elle respirait l’odeur qui suintait par tous les pores de ma peau. Elle me suivait à la trace comme un chien suit le sang d’un animal blessé, elle reniflait ma frayeur. C’était sa drogue, son vice, sa puissance… Ses yeux ne brillaient jamais qu’en ma présence, mais de quelle brillante lumière, celle que l’on voit dans les yeux du toréador avant la mise à mort ou dans ceux du bourreau avant son office.
Mais j’avais d’autres raisons de me morfondre. Les nombreuses années passées en Afrique équatoriale au temps redouté du colonialisme à outrance m’avaient laissé bien plus que des souvenirs. La malaria me poursuivait de ses ardeurs fiévreuses avec une régularité à faire pâlir d’envie un bureaucrate londonien. En un mot, je me retrouvais périodiquement cloué au lit dans un état proche de la catalepsie, incapable de sortir ou même de me nourrir. C’était les moments privilégiés que ma concierge choisissait pour investir mon appartement sous le couvert fallacieux d’une aide quelconque. Selon un scénario préétabli et connu d’elle seule, elle sonnait à la porte pour m’apporter mon courrier. N’entendant qu’un grognement en guise de réponse, elle savait que j’étais dans une de mes crises de paludisme. Il ne lui fallait alors qu’un dixième de seconde pour introduire sa clé dans la serrure et pénétrer dans le saint des saints, mon chez moi, qui devenait rapidement son chez elle pour la durée de ma maladie. Rien n’aurait pu m’être plus pénible. Aucune torture au monde, aucun bourreau expert en son art n’aurait été à même de rivaliser avec elle. Cette femme possédait un don unique : celui de lire à livre ouvert dans les recoins les plus secrets de mon âme afin d’extirper toute la substantifique peur de mon inconscient et me la jeter au visage de ma conscience. A la seule pensée de ces journées abominables où elle cuisinait pour moi, me lisait des passages de quelque volume oublié de l’Apocalypse ou encore restait simplement à mes côtés, je frémis plus sûrement qu’avec toutes les malarias de la terre…
Un moment, pour échapper à son emprise, j’ai même pensé mettre fin à mes jours. Une pendaison, le poison ou saignant à mort dans ma baignoire remplie d’eau chaude. J’y ai songé, et puis j’y ai renoncé, car j’étais convaincu qu’elle serait là à temps, à temps pour me sauver, à temps pour me reconduire dans son cauchemar, pour m’enfermer à nouveau dans le subtil piège de sa présence. Qui sait si elle ne serait pas venue me porter des fruits et des fleurs chaque jour à l’hôpital durant ma convalescence ? En tout cas, elle m’aurait fait regretter amèrement mon geste… Et je n’ose m’imaginer mort et enterré, me réveillant soudain dans le paradis promis avec à mes côtés, sur le velours de mon cercueil, ma concierge souriante et épanouie.
Je n’avais pourtant jamais rien fait qui justifiait cet acharnement sur ma personne. Étant jeune, ma mère m’avait élevé dans le respect d’autrui et m’avait inculqué ce vernis de politesse qui donne à la société humaine ce semblant de brillance. Ainsi, toute ma vie durant, d’hypocrisies courtoises en mensonges polis, j’avais pu donner le change au monde. Avec ma concierge, j’avais agi comme à l’accoutumée. Révérences, courbettes et sourires avaient été les maîtres attitudes de mon quotidien. Mes largesses s’étendaient même au moment tant attendu des étrennes, un petit mot vantant ses mérites de propreté et d’honnêteté accompagnant une somme coquette d’argent que bien des facteurs et autres éboueurs auraient aimé voir tomber dans leur escarcelle à la vente de leur calendrier annuel. Mais au lieu de se voir récompensés par un sourire aimable et un respect digne de nos différences sociales, mes épanchements favorisaient (et entretenaient même) un lien d’esclavage dans lequel on ne discernait plus si le maître était le payeur ou le payé ! Elle me tenait dans sa main et jouait avec moi avec autant d’aisance que son balai et sa serpillière.
Mais pourquoi, me direz-vous, pourquoi ne pas avoir déménagé ? La question montre bien que vous n’avez jamais été sous l’emprise de quelqu’un, et certes pas sous la dépendance de votre concierge. Car maintenant, avec le recul d’un homme ayant accompli une tâche humanitaire, je peux bien vous dire avec certitude qu’elle m’hypnotisait. Derrière ses petites lunettes à monture dorée, son regard bleu acier me lançait des messages subliminaux dignes des plus mauvaises émissions politiques d’outre atlantique. Elle me possédait, prenant mon esprit en otage, rendant vaine toute tentative de fuite. Avec elle, il n’était pas question de ‘glasnost’ et je me sentais plutôt dans la peau d’un albanais, avec un passeport valable entre mon appartement et mon lieu de travail, que dans celle d’un explorateur de l’infini… Elle me poursuivait partout. Dans mon bureau, chaque geste de mes collègues féminines me rappelait sa présence, sans parler des femmes de ménage qui me faisaient sursauter tant leur apparence était proche de mon cerbère femelle. Leur manière de vider les poubelles, leur déhanchement, leurs rires, les mains calleuses et leurs vêtements à fleurs poussiéreux me replongeaient dans l’univers carcéral de mon habitation. Mon cerveau superposait à leurs corps bien réels l’image floue de ce cloporte en chignon qui m’attendait chaque soir derrière ses rideaux délavés et son panneau magique “La concierge est dans l’escalier”.
Le soir, sur le chemin qui menait à mon appartement, j'avais l'occasion de rencontrer des dizaines de concierges, tout aussi affables, qui, sur mon passage, montraient leurs mâchoires édentées dans un sourire sardonique du plus bel effet. Qu'aurais-je donné pour trouver le parcours me menant de mon lieu de travail à mon doux logis qui évitât le plus possible les immeubles abritant une loge de concierge ! Vous pourriez croire que tout cela tournait à l'obsession et que je commençais sérieusement à affabuler, voyant des concierges vampires là où certains voient habituellement des éléphants roses. Mais je vous le dis et le répète, je ne suis pas fou et, de plus, je ne bois jamais une goutte d'alcool, laissant cela à l'humanité dépravée qui jonche les trottoirs le samedi soir à la sortie des bars. Mes cauchemars et mes angoisses étaient bien réels, ils avaient une cause et une seule, le dragon en tablier qui se croyait investi de la sainte mission de protéger mon logis.
J'avais bien essayé de mener une campagne d'information anticoncierge auprès des autres propriétaires de l'immeuble, car, après tout, je n'étais pas le seul concerné. Malheureusement, je dus bien vite céder devant la masse de protestations face à mon étrange ressentiment. Comme d'aucuns l'appelèrent… Je faillis même me brouiller à mort avec un de mes voisins, un certain Yves-Edouard “de Machin Chose”, qui trouvait cette vieille dame si charmante et si serviable que l’on pouvait émettre des doutes quant à leurs relations. La particule n’arrangeant rien à l’affaire, il me somma de faire mes excuses auprès de cette gent dame (ce furent ses mots exacts) sans quoi, il se verrait dans l’obligation de ne plus m’adresser la parole. Grand bien lui fit, nous ne nous parlâmes plus jamais ! Encore une verrue qu’il me faudrait un jour effacer de la surface de la Terre…
Un soir, cependant, alors que je rentrais du travail comme à l’accoutumée, l’Idée germa dans mon esprit. J’en étais arrivé à un tel degré de saturation, de peur et de répulsion que n’importe quelle solution pour me débarrasser d’elle m’aurait paru normale. Mon Idée géniale était simple, claire et précise : la supprimer avant qu’elle ne me rende réellement fou… Ma réflexion avait été étayée ce soir-là par la présence dans le hall d’entrée d’un maçon en train de refaire l’escalier, monumental il faut bien le dire, qui desservait les étages de mon immeuble. Me voyant me diriger vers l’escalier, la concierge me hurla de prendre plutôt l’ascenseur, car ils avaient dû démolir les trois ou quatre premières marches afin d’y inclure je ne sais quel câble électrique ou autre… Je n’entendis jamais la fin, m’étant précipité dans l’ascenseur pour ne pas avoir à discuter plus longtemps des gravats et de la poussière qui devaient certainement embarrasser ma madame propre qui lave plus blanc que blanc. En ouvrant la porte de mon appartement, une vision s’imposa à moi. Il fallait que je mette mon idée en pratique, car elle était digne de mon mal et de l’abjection en tablier qui hantait mes jours et mes nuits.
Il était onze heures bien sonnées lorsque j’entendis le frottement derrière ma porte. Comme d’habitude, la concierge faisait sa ronde avant d’aller enfiler sa chemise de nuit en flanelle à fleurs et de se glisser dans ses draps fraîchement amidonnés. Elle vérifiait que tous ses esclaves étaient bien rentrés et ne regardaient pas le film pornographique du jeudi soir sur une quelconque chaîne privée. Elle s’arrêtait toujours plus longtemps chez moi et je l’imaginais aisément en train de humer au vent l’odeur de ma peur, la truffe en l’air et les yeux injectés… J’avais éteint toutes les lumières pour donner le change et m’étais glissé tout habillé sous les draps. Je respirais à grand renfort de ronflements tonitruants comme, paraît-il, aux dires de ma chère concierge, j’avais coutume de le faire. Ce ne fut qu’une heure plus tard que j’osais sortir de mon lit et de mon appartement. À pas feutrés, je gagnai le premier étage, puis descendant l’escalier jusqu’aux marches fraîchement cimentées, je les enjambai en me laissant glisser sur la grosse rampe en marbre. J’étais à pied d’oeuvre et je n’avais rien oublié. Sans un bruit, je franchis les derniers mètres me séparant de ma victime. Mon coeur battait fort, mais le plaisir de la chasse ancestrale remontait à mes lèvres dans un goût de sang chaud que je n’aurais jamais cru autant apprécier. L’écriteau sur sa porte était retourné et sa loge était aussi noire que le destin que je lui réservais cette nuit-là. Je me mis en devoir de frapper doucement à la porte vitrée jusqu’à ce qu’une voix faible parvienne à mes oreilles tambourinant sous les assauts d’une violente circulation sanguine. Elle n’alluma pas la lumière, voilà qui était inespéré. Elle s’approcha du carreau en grommelant plus que l’usage et les bonnes manières ne l’exigeaient. C’était là une bonne raison de plus pour faire ce que j’avais à faire.
En me voyant, son visage s’éclaira d’un sourire étrange. Croyait-elle que ma visite nocturne avait un autre but que celui que j’avais échafaudé ? Je n’eus pas le temps de répondre à cette question, la porte s’entrouvrit, je m’engouffrai dans la loge et me jetai sur elle avant qu’elle ne pousse le moindre cri. Je frappai avec le couteau un grand nombre de fois dans des endroits divers de son anatomie. Je dois bien vous avouer que je ne me rappelle plus très bien combien de fois, ni où, mais ce que je sais, c’est que le sang gicla bien et fort et qu’elle n’eût pas le temps de pousser le plus petit cri. La première partie de mon plan était achevée. Je me souviens alors d’avoir porté le corps de l’être haï jusqu’à la salle de bain et de l’avoir trouvé bien léger. Sans doute était-ce là l’effet du plaisir que j’éprouvais d’être enfin délivré de ce cafard en tablier… Le reste de la nuit est un peu flou dans ma mémoire. Le découpage de son corps au hachoir m’ayant causé quelques problèmes, je dus recourir à une scie trouvée sur le chantier à côté de l’escalier. Je me rappelle aussi avoir pris un temps considérable afin de nettoyer la loge de toute trace de sang et de lutte. Mais le plus long fut sans doute la préparation du ciment et la finition de l’escalier dans le noir.
Le lendemain matin, pour donner le change, je me rendis à mon travail comme d’habitude, mais, bon sang, comme mon coeur était léger ! Toutes mes angoisses avaient disparu. Je me rappelle même avoir souri en passant devant l’écriteau “La concierge est dans l’escalier”… 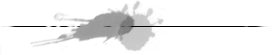
Réagir à ce texte (e-mail à l'auteur) :
|

