21/03/2004 - Marc Bourguignon
Une vie de chien
Dix-sept heures.
L'air est de plus en plus irrespirable, les gosiers raclent, les narines palpitent à la recherche de l'oxygène qui se raréfie.
Partout où mon regard se pose, perçant la brume épaisse, je discerne des multitudes de petites boules incandescentes scintillant de leurs reflets de soleil couchant. Un observateur romanesque y verrait peut-être autant de lucioles insouciantes. Je n'y vois, quant à moi, que la triste réalité : des gitanes qui se consument aux lippes amères de vieillards fatigués.
Les plus jeunes tètent des gauloises en rôdant autour d'un vieux juke-box asthmatique.
Derrière eux j'aperçois la vieille dame qui termine paisiblement la lecture de son journal. Bien sûr, d'où je suis, je ne peux pas lire les caractères imprimés sur le papier, mais je sais que ce canard date d'au moins trente ans. Depuis que son mari s'est couché un beau matin sous une rafale allemande pour une sieste dont il ne s'est jamais réveillé. Ce jour-là, quelque chose s'est cassé dans la tête de cette vénérable vieille dame. Elle puise l'essentiel de son présent dans le passé, côtoyant sans cesse des fantômes oubliés de tous, se berçant d'illusions sur un monde trop pressé.
Plus d'envie, une vie qui se poursuit par la force de l'habitude, des gestes quotidiens qui sont autant d'automatismes conditionnés. La dame n'est déjà plus de ce monde bien qu'elle l'ignore encore. Personne ne la remarque. Elle ne s'intéresse pas aux autres et les autres le lui rendent bien. Je la regarde siroter son picon-bière et je me demande si elle est aussi folle que cela.
À ma droite, un jeune couple semble en proie à une violente discussion. Je ne peux les entendre, mais je vois très bien les larmes scintillantes éclorent dans les yeux de cette si frêle jeune fille. Elle paraît si fragile, comme une chrysalide soumise aux rudes bourrasques d'une réalité qui peut l'anéantir.
J'imagine sa détresse intérieure lorsqu'il lui annonce que tout est fini, son incompréhension puis sa panique et la voix, cette voix qui se lézarde, qui raille et qui finit par exploser dans un torrent de solitude et de pleurs mélangés.
Je repense à la chanson : « je n'ose rien pour elle, que la foule grignote comme un quelconque fruit ».
Le jeune homme se lève, plus très sûr, hésitant, tanguant d'une jambe sur l'autre. Il balbutie quelques mots malhabiles, de ces mots que l'on dit à la place de ceux que l'on voudrait dire, lorsque l'on ne contrôle plus rien. Ces mots qui nous glissent entrent les doigts tel des anguilles mutines et que l'on substitue à des termes blessants, à des lames de rasoir.
Il se sauve, lui aussi, franchit le seuil du bar et ne se retournera pas. Elle le sait. D'une main tremblante, elle recommande un orgeat. La réalité lui cingle la figure. Le Père Noël n'existe plus, les rennes s'en retournent dans les limbes de la bienheureuse enfance, le traîneau tombe en poussière. La nuit sera longue pour toi pauvre fillette.
À ma gauche, une tablée de braillards en goguette pousse la chansonnette. Il y'est question de jeunes vierges et de marins pervers qui reviennent du Cap, chargés d'épices et de boissons. Ça ripaille, ça s'imbibe.
Ils boivent par lâcheté, pour oublier qu'ils ne contrôlent même par leur pitoyable existence. Sans doute aucun d'entre eux ne mettra jamais les pieds sur un bateau, mais peu importe : les chopines claquent dans des jaillissements dorés de bières brunes, sous les décibels abusifs de ces rires éraillés. Dans un coin, attroupés autour d'un vieux juke-box, quelques jeunes semblent avoir oublié le temps et l'heure. Les paupières mi-closes ils se refont Woodstock. C'est Hendrix qui déchire, The Who qui met le feu et Baez qui paye la tournée. Les jeunes filles ondulent du bassin, faisant saillir de petites fesses comprimées plus que de raison dans des jeans trop étroits, sous les regards lubriques des bons pères de familles qui descendent leurs décas, attentifs toutefois aux déhanchements aguicheurs de ces fausses adultes qui se prennent pour des femmes.
Tout ce petit monde semble se comprendre du regard. Ça scintille, ça cligne, ça invite. Et cela se terminera probablement dans la petite ruelle, sur la banquette en skaï de la grosse familiale entre le hochet du dernier et les chaussures de foot de l'aîné.
Aucun complexe. Du sexe... du latex. C'est la nouvelle façon de vivre. Vivons aussi.
Mon regard se repose une ultime fois sur cette jeune naïade esseulée, pleurant un amour déçu qui précède le suivant : « je n'ose rien pour elle... ».
Je me couche par terre, devant le bar. Personne ne fait attention à moi. Un relent de bière tiède et de vomissure me monte aux narines. J'allonge mon museau sur mes pattes avant et ferme une fois encore mes yeux sur ce monde sans amour où les hommes sont hommes et les chiens ne sont rien... 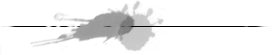
Réagir à ce texte (e-mail à l'auteur) :
|

